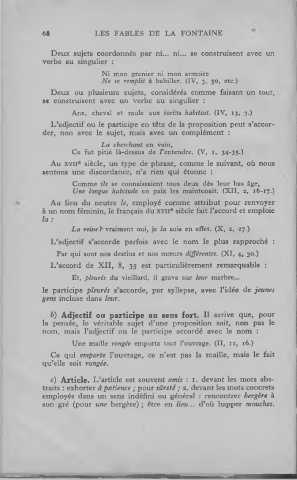Page 72 - Les fables de Lafontaine
P. 72
68 LES FABLES DE LA FONTAINE
Deux sujets coordonnés par ni... ni... se construisent avec un
verbe au singulier :
Ni mon grenier ni mon armoire
Ne se remplit à babiller. (IV, 3, 50, etc.)
Deux ou plusieurs sujets, considérés comme faisant un tout,
se construisent avec un verbe au singulier :
Ane, cheval et mule aux forêts habitait. (IV, 13, 3.)
L’adjectif ou le participe en tête de la proposition peut s’accor
der, non avec le sujet, mais avec un complément :
La cherchant en vain,
Ce fut pitié là-dessus de l’entendre. (V, I, 34-35.)
Au xvne siècle, un type de phrase, comme le suivant, où nous
sentons une discordance, n’a rien qui étonne :
Comme ils se connaissaient tous deux dès leur bas âge,
Une longue habitude en paix les maintenait. (XII, 2, 16-17.)
Au lieu du neutre le, employé comme attribut pour renvoyer
à un nom féminin, le français du xvne siècle fait l’accord et emploie
la :
La reine l- vraiment oui, je la suis en effet. (X, 2, 27.)
L’adjectif s’accorde parfois avec le nom le plus rapproché :
Par qui sont nos destins et nos mœurs différentes. (XI, 4, 30.)
L’accord de XII, 8, 35 est particulièrement remarquable :
Et, pleurés du vieillard, il grava sur leur marbre...
le participe pleurés s’accorde, par syllepse, avec l’idée de jeunes
gens incluse dans leur.
b) Adjectif ou participe au sens fort. Il arrive que, pour
la pensée, le véritable sujet d’une proposition soit, non pas le
nom, mais l’adjectif ou le participe accordé avec le nom :
Une maille rongée emporta tout l’ouvrage. (II, il, 16.)
Ce qui emporte l’ouvrage, ce n’est pas la maille, mais le fait
qu’elle soit rongée.
c) Article. L’article est souvent omis : 1. devant les mots abs
traits : exhorter à patience ; pour sûreté ; 2. devant les mots concrets
employés dans un sens indéfini ou général : rencontrer bergère à
son gré (pour une bergère) ; être en lieu... d’où happer mouches.