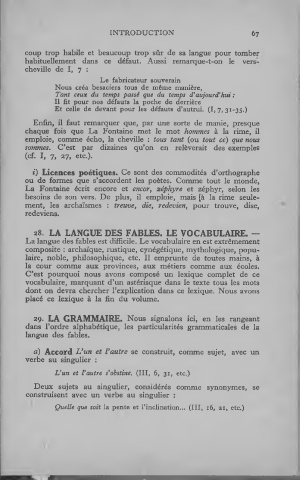Page 71 - Les fables de Lafontaine
P. 71
INTRODUCTION 67
coup trop habile et beaucoup trop sûr de sa langue pour tomber
habituellement dans ce défaut. Aussi remarque-t-on le vers-
cheville de I, 7 :
Le fabricateur souverain
Nous créa besaciers tous de même manière,
Tant ceux du temps passé que du temps d’aujourd'hui :
Il fit pour nos défauts la poche de derrière
Et celle de devant pour les défauts d’autrui. (1,7,31-35.)
Enfin, il faut remarquer que, par une sorte de manie, presque
chaque fois que La Fontaine met le mot hommes à la rime, il
emploie, comme écho, la cheville : tous tant (ou tout ce) que nous
sommes. C’est par dizaines qu’on en relèverait des exemples
(cf- I, 7> 37. etc.).
i) Licences poétiques. Ce sont des commodités d’orthographe
ou de formes que s’accordent les poètes. Comme tout le monde,
La Fontaine écrit encore et encor, zéphyre et zéphyr, selon les
besoins de son vers. De plus, il emploie, mais [à la rime seule
ment, les archaïsmes : treuve, die, redevien, pour trouve, dise,
redeviens.
28. LA LANGUE DES FABLES. LE VOCABULAIRE. —
La langue des fables est difficile. Le vocabulaire en est extrêmement
composite : archaïque, rustique, cynégétique, mythologique, popu
laire, noble, philosophique, etc. Il emprunte de toutes mains, à
la cour comme aux provinces, aux métiers comme aux écoles.
C’est pourquoi nous avons composé un lexique complet de ce
vocabulaire, marquant d’un astérisque dans le texte tous les mots
dont on devra chercher l’explication dans ce lexique. Nous avons
placé ce lexique à la fin du volume.
29. LA GRAMMAIRE. Nous signalons ici, en les rangeant
dans l’ordre alphabétique, les particularités grammaticales de la
langue des fables.
a) Accord L’un et Vautre se construit, comme sujet, avec un
verbe au singulier :
L’un et Vautre s'obstine. (III, 6, 31, etc.)
Deux sujets au singulier, considérés comme synonymes, se
construisent avec un verbe au singulier :
Quelle que soit la pente et l’inclination... (III, 16, 21, etc.)