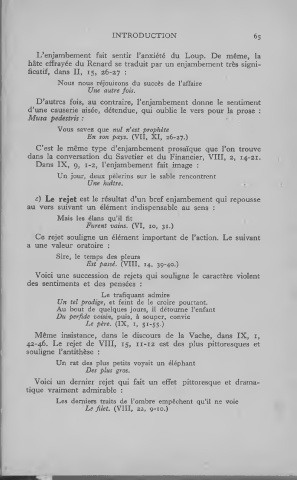Page 69 - Les fables de Lafontaine
P. 69
INTRODUCTION 65
L’enjambement fait sentir l’anxiété du Loup. De même, la
hâte effrayée du Renard se traduit par un enjambement très signi
ficatif, dans II, 15, 26-27 :
Nous nous réjouirons du succès de l’affaire
Une autre fois.
D’autres fois, au contraire, l’enjambement donne le sentiment
d’une causerie aisée, détendue, qui oublie le vers pour la prose :
Musa pedestris : r
Vous savez que nul n’est prophète
En son pays. (VII, XI, 26-27.)
C’est le même type d’enjambement prosaïque que l’on trouve
dans la conversation du Savetier et du Financier, VIII, 2, 14-21.
Dans IX, 9, 1-2, l’enjambement fait image :
Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent
Une huître.
c) Le rejet est le résultat d’un bref enjambement qui repousse
au vers suivant un élément indispensable au sens :
Mais les élans qu’il fit
Furent vains. (VI, 10, 31.)
Ce rejet souligne un élément important de l’action. Le suivant
a une valeur oratoire :
Sire, le temps des pleurs
Est passé. (VIII, 14, 39-40.)
Voici une succession de rejets qui souligne le caractère violent
des sentiments et des pensées :
Le trafiquant admire
Un tel prodige, et feint de le croire pourtant.
Au bout de quelques jours, il détourne l’enfant
Du perfide voisin, puis, à souper, convie
Le père. (IX, 1, 51-55.)
Même insistance, dans le discours de la Vache, dans IX, 1,
42-46. Le rejet de VIII, 15, 11-12 est des plus pittoresques et
souligne l’antithèse :
Un rat des plus petits voyait un éléphant
Des plus gros.
Voici un dernier rejet qui fait un effet pittoresque et drama
tique vraiment admirable :
Les derniers traits de l’ombre empêchent qu’il ne voie
Le filet. (VIII, 22, 9-10.)