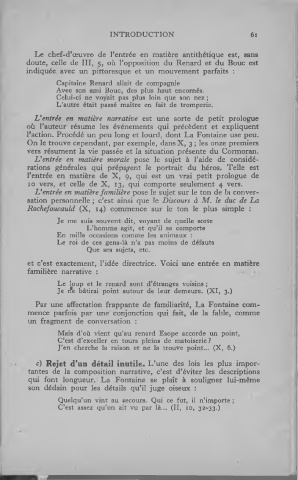Page 65 - Les fables de Lafontaine
P. 65
INTRODUCTION 61
Le chef-d’œuvre de l’entrée en matière antithétique est, sans
doute, celle de III, 5, où l’opposition du Renard et du Bouc est
indiquée avec un pittoresque et un mouvement parfaits :
Capitaine Renard allait de compagnie
Avec son ami Bouc, des plus haut encornés.
Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez ;
L’autre était passé maître en fait de tromperie.
L’entrée en matière narrative est une sorte de petit prologue
où l’auteur résume les événements qui précèdent et expliquent
l’action. Procédé un peu long et lourd, dont La Fontaine use peu.
On le trouve cependant, par exemple, dans X, 3 ; les onze premiers
vers résument la vie passée et la situation présente du Cormoran.
L’entrée en matière morale pose le sujet à l’aide de considé
rations générales qui prépaient le portrait du héros. Telle est
l’entrée en matière de X, 9, qui est un vrai petit prologue de
10 vers, et celle de X, 13, qui comporte seulement 4 vers.
L’entrée en matière familière pose le sujet sur le ton de la conver
sation personnelle ; c’est ainsi que le Discours à M. le duc de La
Rochefoucauld (X, 14) commence sur le ton le plus simple :
Je me suis souvent dit, voyant de quelle sorte
L’homme agit, et qu’il se comporte
En mille occasions comme les animaux :
Le roi de ces gens-là n’a pas moins de défauts
Que ses sujets, etc.
et c’est exactement, l’idée directrice. Voici une entrée en matière
familière narrative :
Le loup et le renard sont d’étranges voisins ;
Je rfe bâtirai point autour de leur demeure. (XI, 3.)
Par une affectation frappante de familiarité, La Fontaine com
mence parfois par une conjonction qui fait, de la fable, comme
un fragment de conversation :
Mais d’où vient qu’au renard Esope accorde un point,
C’est d’exceller en tours pleins de matoiserie?
J’en cherche la raison et ne la trouve point... (X, 6.)
c) Rejet d’un détail inutile. L’une des lois les plus impor
tantes de la composition narrative, c’est d’éviter les descriptions
qui font longueur. La Fontaine se plaît à souligner lui-même
son dédain pour les détails qu’il juge oiseux :
Quelqu’un vint au secours. Qui ce fut, il n’importe ;
C’est assez qu’on ait vu par là... (II, 10, 32-33.)