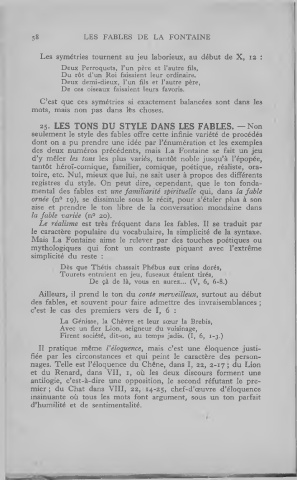Page 62 - Les fables de Lafontaine
P. 62
58 LES FABLES DE LA FONTAINE
Les symétries tournent au jeu laborieux, au début de X, 12 :
Deux Perroquets, l’un père et l’autre fils,
Du rôt d’un Roi faisaient leur ordinaire.
Deux demi-dieux, l’un fils et l’autre père,
De ces oiseaux faisaient leurs favoris.
C’est que ces symétries si exactement balancées sont dans les
mots, mais non pas dans lés choses.
25. LES TONS DU STYLE DANS LES FABLES. — Non
seulement le style des fables offre cette infinie variété de procédés
dont on a pu prendre une idée par l’énumération et les exemples
des deux numéros précédents, mais La Fontaine se fait un jeu
d’y mêler les tons les plus variés, tantôt noble jusqu’à l’épopée,
tantôt héroï-comique, familier, comique, poétique, réaliste, ora
toire, etc. Nul, mieux que lui, ne sait user à propos des différents
registres du style. On peut dire, cependant, que le ton fonda
mental des fables est une familiarité spirituelle qui, dans la fable
ornée (n° 19), se dissimule sous le récit, pour s’étaler plus à son
aise et prendre le ton libre de la conversation mondaine dans
la fable variée (n° 20).
Le réalisme est très fréquent dans les fables. Il se traduit par
le caractère populaire du vocabulaire, la simplicité de la syntaxe.
Mais La Fontaine aime le relever par des touches poétiques ou
mythologiques qui font un contraste piquant avec l’extrême
simplicité du reste :
Dès que Thétis chassait Phébus aux crins dorés,
Tourets entraient en jeu, fuseaux étaient tirés,
De çà de là, vous en aurez... (V, 6, 6-8.)
Ailleurs, il prend le ton du conte merveilleux, surtout au début
des fables, et souvent pour faire admettre des invraisemblances ;
c’est le cas des premiers Vers de I, 6 :
La Génisse, la Chèvre et leur sœur la Brebis,
Avec un fier Lion, seigneur du voisinage,
Firent société, dit-on, au temps jadis. (I, 6, 1-3.)
Il pratique même l’éloquence, mais c’est une éloquence justi
fiée par les circonstances et qui peint le caractère des person
nages. Telle est l’éloquence du Chêne, dans I, 22, 2-17 ; du Lion
et du Renard, dans VII, 1, où les deux discours forment une
antilogie, c’est-à-dire une opposition, le second réfutant le pre
mier ; du Chat dans VIII, 22, 14-25, chef-d’œuvre d’éloquence
insinuante où tous les mots font argument, sous un ton parfait
d’humilité et de sentimentalité.