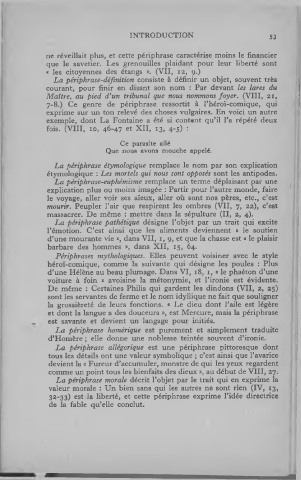Page 57 - Les fables de Lafontaine
P. 57
INTRODUCTION 53
ne réveillait plus, et cette périphrase caractérise moins le financier
que le savetier. Les grenouilles plaidant pour leur liberté sont
« les citoyennes des étangs ». (VII, 12, 9.)
La périphrase-définition consiste à définir un objet, souvent très
courant, pour finir en disant son nom : Par devant les lares du
Maître, au pied d’un tribunal que nous nommons foyer. (VIII, 21,
7-8.) Ce genre de périphrase ressortit à l’héroï-comique, qui
exprime sur un ton relevé des choses vulgaires. En voici un autre
exemple, dont La Fontaine a été si contant qu’il l’a répété deux
fois. (VIII, 10, 46-47 et XII, 13, 4-5) :
Ce parasite ailé
Que nous avons mouche appelé.
La périphrase étymologique remplace le nom par son explication
étymologique : Les mortels qui nous sont opposés sont les antipodes.
La périphrase-euphémisme remplace un terme déplaisant par une
explication plus ou moins imagée : Partir pour l’autre monde, faire
le voyage, aller voir ses aïeux, aller où sont nos pères, etc., c’est
mourir. Peupler l’air que respirent les ombres (VII, 7, 22), c’est
massacrer. De même : mettre dans la sépulture (II, 2, 4).
La périphrase pathétique désigne l’objet par un trait qui excite
l’émotion. C’est ainsi que les aliments deviennent « le soutien
d’une mourante vie », dans VII, 1, 9, et que la chasse est « le plaisir
barbare des hommes », dans XII, 15, 64.
Périphrases mythologiques. Elles peuvent voisiner avec le style
héroï-comique, comme la suivante qui désigne les poules : Plus
d’une Hélène au beau plumage. Dans VI, 18, 1, « le phaéton d’une
voiture à foin » avoisine la métonymie, et l’ironie est évidente.
De même : Certaines Philis qui gardent les dindons (VII, 2, 25)
sont les servantes de ferme et le nom idyllique ne fait que souligner
la grossièreté de leurs fonctions. « Le dieu dont l’aile est légère
et dont la langue a des douceurs », est Mercure, mais la périphrase
est savante et devient un langage pour initiés.
La périphrase homérique est purement et simplement traduite
d’Homère ; elle donne une noblesse teintée souvent d’ironie.
La périphrase allégorique est une périphrase pittoresque dont
tous les détails ont une valeur symbolique ; c’est ainsi que l’avarice
devient la « Fureur d’accumuler, monstre de qui les yeux regardent
comme un point tous les bienfaits des dieux », au début de VIII, 27.
La périphrase morale décrit l’objet par le trait qui en exprime la
valeur morale : Un bien sans qui les autres ne sont rien (IV, 13,
32-33) est la liberté, et cette périphrase exprime l’idée directrice
de la fable qu’elle conclut.