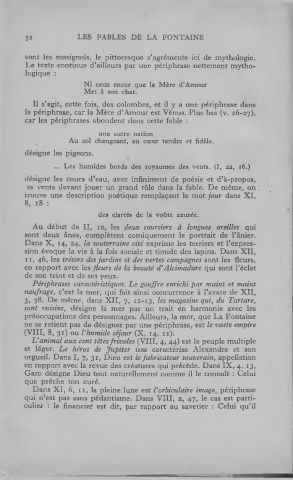Page 56 - Les fables de Lafontaine
P. 56
52 LES FABLES DE LA FONTAINE
sont les rossignols, le pittoresque s’agrémente ici de mythologie.
Le texte continue d’ailleurs par une périphrase nettement mytho
logique :
Ni ceux encor que la Mère d’Amour
Met à son char.
Il s’agit, cette fois, des colombes, et il y a une périphrase dans
la périphrase, car la Mère d’Amour est Vénus. Plus bas (v. 26-27),
car les périphrases abondent dans cette fable :
une autre nation
Au col changeant, au cœur tendre et fidèle,
désigne les pigeons.
... Les humides bords des royaumes des vents. (I, 22, 16.)
désigne les cours d’eau, avec infiniment de poésie et d’à-propos,
es vents devant jouer un grand rôle dans la fable. De même, on
trouve une description poétique remplaçant le mot jour dans XI,
8, 18 :
des clartés de la voûte azurée.
Au début de II, 10, les deux coursiers à longues oreilles qui
sont deux ânes, complètent comiquement le portrait de l’ànier.
Dans X, 14, 24, la souterraine cité exprime les terriers et l’expres
sion évoque la vie à la fois sociale et timide des lapins. Dans XII,
11, 46, les trésors des jardins et des vertes campagnes sont les fleurs,
en rapport avec les fleurs de la beauté d’Alcimadure qui sont l’éclat
de son teint et de ses yeux.
Périphrases caractéristiques. Le gouffre enrichi par maint et maint
naufrage, c’est la mer, qui fait ainsi concurrence à l’avare de XII,
3, 38. De même, dans XII, 7, 12-13, les magasins qui, du Tartare,
sont voisins, désigne la mer par un trait en harmonie avec les
préoccupations des personnages. Ailleurs, la mer, que La Fontaine
ne se retient pas de désigner par une périphrase, est le vaste empire
(VIII, 8, 31) ou l’humide séjour (X, 14, 11).
L’animal aux cent têtes frivoles (VIH, 4, 44) est le peuple multiple
et léger. Le héros de Jupiter issu caractérise Alexandre et son
orgueil. Dans I, 7, 31, Dieu est le fabricateur souverain, appellation
en rapport avec la revue des créatures qui précède. Dans IX, 4, 13,
Garo désigne Dieu tout naturellement comme il le connaît : Celui
que prêche ton curé.
Dans XI, 6, 11, la pleine lune est l’orbiculaire image, périphrase
qui n’est pas sans pédantisme. Dans VIII, 2, 47, le cas est parti
culier : le financier est dit, par rapport au savetier : Celui qu’il