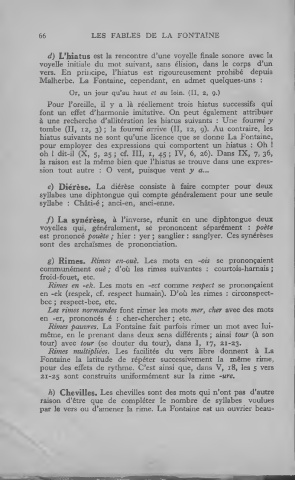Page 70 - Les fables de Lafontaine
P. 70
66 LES FABLES DE LA FONTAINE
d) L’hiatus est la rencontre d’une voyelle finale sonore avec la
voyelle initiale du mot suivant, sans élision, dans le corps d’un
vers. En principe, l’hiatus est rigoureusement prohibé depuis
Malherbe. La Fontaine, cependant, en admet quelques-uns :
Or, un jour qu’au haut et au loin. (Il, 2, 9.)
Pour l’oreille, il y a là réellement trois hiatus successifs qui
font un effet d’harmonie imitative. On peut également attribuer
à une recherche d’allitération les hiatus suivants : Une fourmi y
tombe (II, 12, 3) ; la fourmi arrive (II, 12, 9). Au contraire, les
hiatus suivants ne sont qu’une licence que se donne La Fontaine,
pour employer des expressions qui comportent un hiatus : Oh !
oh ! dit-il (X, 5, 25 ; cf. III, 1, 45 ; IV, 6, 26). Dans IX, 7, 36,
la raison est la même bien que l’hiatus se trouve dans une expres
sion tout autre : O vent, puisque vent y a...
e) Diérèse. La diérèse consiste à faire compter pour deux
syllabes une diphtongue qui compte généralement pour une seule
syllabe : Châti-é ; anci-en, anci-enne.
/) La synérèse, à l’inverse, réunit en une diphtongue deux
voyelles qui, généralement, sé prononcent séparément : poète
est prononcé pouète ; hier : yer ; sanglier : sanglyer. Ces synérèses
sont des archaïsmes de prononciation.
g) Rimes. Rimes en-ouè. Les mots en -ois se prononçaient
communément ouè ; d’où les rimes suivantes : courtois-harnais ;
froid-fouet, etc.
Rimes en -ek. Les mots en -ect comme respect se prononçaient
en -ek (respek, cf. respect humain). D’où les rimes : circonspect-
bec ; respect-bec, etc.
Les rimes normandes font rimer les mots mer, cher avec des mots
en -er, prononcés é : cher-chercher ; etc.
Rimes pauvres. La Fontaine fait parfois rimer un mot avec lui-
même, en le prenant dans deux sens différents ; ainsi tour (à son
tour) avec tour (se douter du tour), dans I, 17, 21-23.
Rimes multipliées. Les facilités du vers libre donnent à La
Fontaine la latitude de répéter successivement la même rime,
pour des effets de rythme. C’est ainsi que, dans V, 18, les 5 vers
21-25 sont construits uniformément sur la rime -ure.
li) Chevilles. Les chevilles sont des mots qui n’ont pas d’autre
raison d’être que de compléter le nombre de syllabes voulues
par le vers ou d’amener la rime. La Fontaine est un ouvrier beau