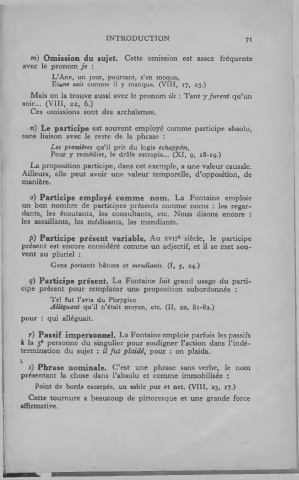Page 75 - Les fables de Lafontaine
P. 75
INTRODUCTION 71
ni) Omission du sujet. Cette omission est assez fréquente
avec le pronom je :,
L’Ane, un jour, pourtant, s’en moqua,
Et>ne sais comme il y manqua. (VIII, 17, 23.)
Mais on la trouve aussi avec le pronom ils : Tant y furent qu’un
soir... (VIII, 22, 6.)
Ces omissions sont des archaïsmes.
n) Le participe est souvent employé comme participe absolu,
sans liaison avec le reste de la phrase :
Les premières qu’il prit du logis échappées,
Pour y remédier, le drôle estropia... (XI, 9, 18-19.)
La proposition participe, dans cet exemple, a une valeur causale.
Ailleurs, elle peut avoir une valeur temporelle, d’opposition, de
manière.
o) Participe employé comme nom. La Fontaine emploie
un bon nombre de participes présents comme noms : les regar
dants, les écoutants, les consultants, etc. Nous disons encore :
les assaillants, les médisants, les mendiants.
P) Participe présent variable. Au xvne siècle, le participe
présent est encore considéré comme un adjectif, et il se met sou
vent au pluriel :
Gens portants bâtons et mendiants. (I, 5, 24.)
?) Participe présent. La Fontaine fait grand usage du parti
cipe présent pour remplacer une proposition subordonnée :
Tel fut l’avis du Phrygien
Alléguant qu’il n’était moyen, etc. (II, 20, 81-82.)
pour : qui alléguait.
r) Passif impersonnel. La Fontaine emploie parfois les passifs
à la 3e personne du singulier pour souligner l’action dans l’indé
termination du sujet : il fut plaidé, pour : on plaida.
L
r) Phrase nominale. C’est une phrase sans verbe, le nom
présentant la chose dans l’absolu et comme immobilisée :
Point de bords escarpés, un sable pur et net. (VIII, 23, 17.)
Cette tournure a beaucoup de pittoresque et une grande force
affirmative.