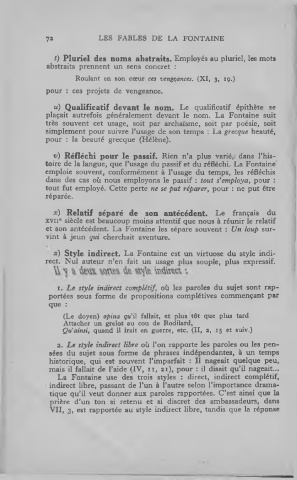Page 76 - Les fables de Lafontaine
P. 76
7» LES FABLES DE LA FONTAINE
t) Pluriel des noms abstraits. Employés au pluriel, les mots
abstraits prennent un sens concret :
Roulant en son cœur ces vengeances. (XI, 3, 19.)
pour : ces projets de vengeance.
u) Qualificatif devant le nom. Le qualificatif épithète se
plaçait autrefois généralement devant le nom. La Fontaine suit
très souvent cet usage, soit par archaïsme, soit par poésie, soit
simplement pour suivre l’usage de son temps : La grecque beauté,
pour : la beauté grecque (Hélène).
f) Réfléchi pour le passif. Rien n’a plus varié, dans l’his
toire de la langue, que l’usage du passif et du réfléchi. La Fontaine'
emploie souvent, conformément à l’usage du temps, les réfléchis
dans des cas où nous employons le passif : tout s’employa, pour :
tout fut employé. Cette perte ne se put réparer, pour : ne put être
réparée.
x) Relatif séparé de son antécédent. Le français du
XVIIe siècle est beaucoup moins attentif que nous à réunir le relatif
et son antécédent. La Fontaine les sépare souvent : Un loup sur
vint à jeun qui cherchait aventure.
2) Style indirect. La Fontaine est un virtuose du style indi
rect. Nul auteur n’en fait un usage plus souple, plus expressif.
1. Le style indirect complétif, où les paroles du sujet sont rap
portées sous forme de propositions complétives commençant par
que :
(Le doyen) opina qu’il fallait, et plus tôt que plus tard
Attacher un grelot au cou de Rodilard,
Qu’ainsi, quand il irait en guerre, etc. (II, 2, 15 et suiv.)
2. Le style indirect libre où l’on rapporte les paroles ou les pen
sées du sujet sous forme de phrases indépendantes, à un temps
historique, qui est souvent l’imparfait : Il nageait quelque peu,
mais il fallait de l’aide (IV, 11, 21), pour : il disait qu’il nageait...
La Fontaine use des trois styles : direct, indirect complétif,
indirect libre, passant de l’un à l’autre selon l’importance drama
tique qu’il veut donner aux paroles rapportées. C’est ainsi que la
prière d’un ton si retenu et si discret des ambassadeurs, dans
VII, 3, est rapportée au style indirect libre, tandis que la réponse