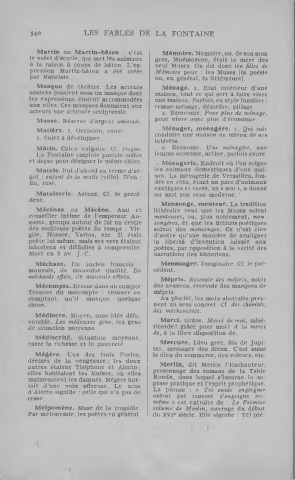Page 542 - Les fables de Lafontaine
P. 542
540 LES FABLES DE LA FONTAINE
Martin ou Martin-bâton : c’est Mémoire. Mémoire, ou, de son nom
le valet d’écurie, qui met lés animaux grec, Mnémosvne, était la mère des
à la raison à coups de bâton, d’ex neuf Muses. Ou dit donc les filles de
pression Martin-bâton a été créée Mémoire pour : les Muses (la poésie
par Rabelais. ou, en général, la littérature).
Masque de théâtre. Iyes acteurs Ménage, i. Etat intérieur d’une
anciens jouaient sous un masque dont maison, tout ce qui sert à faire vivre
les expressions étaient’ accommodées une maison. Parfois, en style familier :
aux rôles. Ces masques donnaient aux remue-ménage, désordre, pillage.
acteurs une attitude sculpturale. 2. Economie. Pour plus de ménage,
pour vivre ayec plus d’économie.
Masse. Réserve d’argent amassée.
Matière, i. Occasion, cause. Ménager, ménagère, i. Qui sait
2. Sujet à développer. conduire une maison au mieux de ses
intérêts.
Mâtin. Chien vulgaire. Ci. Dogue. 2. Econome. Une ménagère, une
da Fontaine emploie parfois mâtin femme économe, active, parfois avare.
et dogue pour désigner le même chien. , Ménagerie. Endroit où l’on soigne
Matois. Fut d’abord un terme d’ar les animaux domestiques d’une mai
got’ : enfant de la matte (ville). D’où : son. Ea ménagerie de Versailles, fon
fin, rusé. dée en 1662, étant un parc d’animaux
exotiques et rares, un « zoo », a donné
Matoiserie. Astuce. Cf. le précé au mot son sens moderne. '
dent. Mensonge, menteur. Ea tradition
Mécénas ou Mécène. Ami et littéraire veut que les Muses soient
conseiller intime de l’empereur Au menteuses, ou, plus noblement, men
guste, groupa autour de lui un cercle songères, et que les fictions poétiques
des meilleurs poètes du temps : Vir soient des mensonges. Ce n’est rien
gile, Horace, Varius, etc. Il était d’autre qu’une manière de souligner
poète lui-même, mais ses vers étaient la liberté d’invention laissée aux
laborieux et difficiles à comprendre. poètes, par opposition à la vérité des
Mort en 8 av. J.-C. narrations des historiens.
Méchant. En ancien français : Mensonger. Imaginaire. Cf. le pré
mauvais, de mauvaise qualité. De cédent.
méchants effets, de mauvais effets. Mépris. Recevoir des mépris, subir
Mécompte. Erreur dans un compte des avances, recevoir des marques de
Trouver du mécompte ; trouver en mépris.
comptant qu’il manque quelque Au pluriel, les mots abstraits pren
chose. nent un sens concret. Cf. des charités,
des méchancetés.
Médiocre. Moyen, sans idée défa
vorable. Les médiocres gens, les gens Merci. Grâce. Merci de moi, misé
de situation moyenne. ricorde ! grâce pour moi ! A la merci
de, à la libre disposition de.
Médiocrité. Situation moyenne,
entre la richesse et la pauvreté. Mercure. Dieu grec, fils de Jupi
ter, messager des dieux. C’est aussi
Mégère. Une des trois Furies, le dieu du commerce, des voleurs, etc.
déesses de la vengeance ; les deux
autres étaient Tisiphone et Alecto ; Merlin, dit Merlin l’Enchanteur,
elles habitaient les Enfers, où elles personnage des romans de la Table
malmenaient les damnés. Mégère hur Ronde, dans lequel s’incarne la sa
lait d’une voix affreuse. Ee nom gesse pratique et l’esprit prophétique.
d’Alecto signifie : celle qui n’a pas de Ea phrase : « Tel cuide engeigner
cesse. autrui qui souvent s’engeigne soi-
même » est extraite de : Le Premier
Melpomène. Muse de la tragédie. volume de Merlin, ouvrage du début
Par métonymie, les poètes en général. du xvi* siècle. Elle signifie : Tel pré