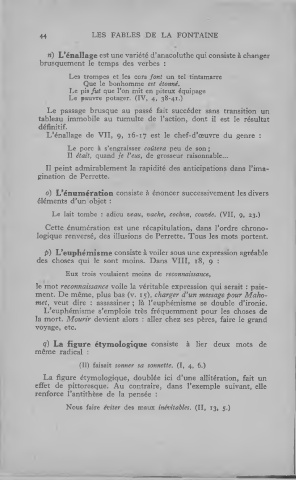Page 48 - Les fables de Lafontaine
P. 48
44 LES FABLES DE LA FONTAINE
n) L’énallage est une variété d’anacoluthe qui consiste à changer
brusquement le temps des verbes :
Les trompes et les cors font un tel tintamarre
Que le bonhomme est étonné.
Le pis fut que l’on mit en piteux équipage
Le pauvre potager. (IV, 4, 38-41.)
Le passage brusque au passé fait succéder sans transition un
tableau immobile au tumulte de l’action, dont il est le résultat
définitif.
L’énallage de VII, 9, 16-17 est Ie chef-d’œuvre du genre :
Le porc à s’engraisser coûtera peu de son ;
Il était, quand je l’eus, de grosseur raisonnable...
Il peint admirablement la rapidité des anticipations dans l’ima
gination de Perrette.
0) L’énumération consiste à énoncer successivement les divers
éléments d’un objet :
Le lait tombe : adieu veau, vache, cochon, couvée. (VII, g, 23.)
Cette énumération est une récapitulation, dans l’ordre chrono
logique renversé, des illusions de Perrette. Tous les mots portent.
/>) L’euphémisme consiste à voiler sous une expression agréable
des choses qui le sont moins. Dans VIII, 18, 9 :
Eux trois voulaient moins de reconnaissance,
le mot reconnaissance voile la véritable expression qui serait : paie
ment. De même, plus bas (v. 15), charger d’un message pour Maho
met, veut dire : assassiner ; là l’euphémisme se double d’ironie.
L’euphémisme s’emploie très fréquemment pour les choses de
la mort. Mourir devient alors : aller chez ses pères, faire le grand
voyage, etc.
<?) La figure étymologique consiste à lier deux mots de
même radical :
(II) faisait sonner sa sonnette. (I, 4, 6.)
La figure étymologique, doublée ici d’une allitération, fait un
effet de pittoresque. Au contraire, dans l’exemple suivant, elle
renforce l’antithèse de la pensée :
Nous faire éviter des maux inévitables. (II, 13, 5.)