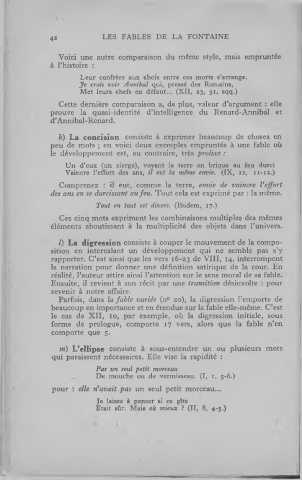Page 46 - Les fables de Lafontaine
P. 46
LES FABLES DE LA FONTAINE
42
Voici une autre comparaison du même style, mais empruntée
à l’histoire :
Leur confrère aux abois entre ces morts s’arrange.
Je crois voir Annibal qui, pressé des Romains,
Met leurs chefs en défaut... (XII, 23, 31, sqq.)
Cette dernière comparaison a, de plus, valeur d’argument : elle
prouve la quasi-identité d’intelligence du Renard-Annibal et
d’Annibal-Renard.
k) La concision consiste à exprimer beaucoup de choses en
peu de mots ; en voici deux exemples empruntés à une fable où
le développement est, au contraire, très prolixe :
Un d’eux (un cierge), voyant la terre en brique au feu durci
Vaincre l’effort des ans, |7 eut la même envie. (IX, 12, 11-12.)
Comprenez : il eut, comme la terre, envie de vaincre l’effort
des ans en se durcissant au feu. Tout cela est exprimé par : la même.
Tout en tout est divers. (Ibidem, 17.)
Ces cinq mots expriment les combinaisons multiples des mêmes
éléments aboutissant à la multiplicité des objets dans l’univers.
Z) La digression consiste à couper le mouvement de la compo
sition en intercalant un développement qui ne semble pas s’y
rapporter. C’est ainsi que les vers 16-23 de VIII, 14, interrompent
la narration pour donner une définition satirique de la cour. En
réalité, l’auteur attire ainsi l’attention sur le sens moral de sa fable.
Ensuite, il revient à son récit par une transition désinvolte : pour
revenir à notre affaire.
Parfois, dans la fable variée (n° 20), la digression l’emporte de
beaucoup en importance et en étendue sur la fable elle-même. C’est
le cas de XII, 10, par exemple, où la digression initiale, sous
forme de prologue, comporte 17 vers, alors que la fable n’en
comporte que 5.
m) L’ellipse consiste à sous-entendre un ou plusieurs mots
qui paraissent nécessaires. Elle vise la rapidité :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau. (I, 1, 5-6.)
pour : elle n’avait pas un seul petit morceau-
Je laisse à penser si ce gîte
Etait sûr. Mais où mieux ? (Il, 8, 4-5.)