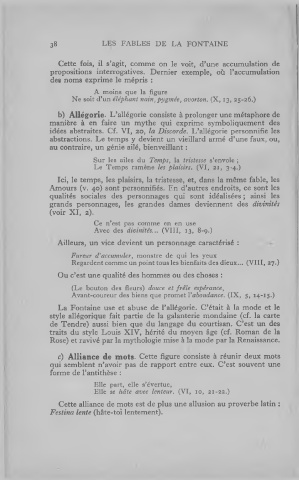Page 42 - Les fables de Lafontaine
P. 42
38 LES FABLES DE LA FONTAINE
Cette fois, il s’agit, comme on le voit, d’une accumulation de
propositions interrogatives. Dernier exemple, où l’accumulation
des noms exprime le mépris :
A moins que la figure
Ne soit d’un éléphant nain, pygmée, avorton. (X, 13, 25-26.)
b) Allégorie. L’allégorie consiste à prolonger une métaphore de
manière à en faire un mythe qui exprime symboliquement des
idées abstraites. Cf. VI, 20, la Discorde. L’allégorie personnifie les
abstractions. Le temps y devient un vieillard armé d’une faux, ou,
au contraire, un génie ailé, bienveillant :
Sur les ailes du Temps, la tristesse s’envole ;
Le Temps ramène les plaisirs. (VI, 21, 3-4.)
Ici, le temps, les plaisirs, la tristesse, et, dans la même fable, les
Amours (v. 40) sont personnifiés. En d’autres endroits, ce sont les
qualités sociales des personnages qui sont idéalisées ; ainsi les
grands personnages, les grandes dames deviennent des divinités
(voir XI, 2).
Ce n’est pas comme en en use
Avec des divinités... (VIII, 13, 8-9.)
Ailleurs, un vice devient un personnage caractérisé :
Fureur d’accumuler, monstre de qui les yeux
Regardent comme un point tous les bienfaits des dieux... (VIII, 27.)
Ou c’est une qualité des hommes ou des choses :
(Le bouton des fleurs) douce et frêle espérance,
Avant-coureur des biens que promet F abondance. (IX, 5, 14-15.)
La Fontaine use et abuse de l’allégorie. C’était à la mode et le
style allégorique fait partie de la galanterie mondaine (cf. la carte
de Tendre) aussi bien que du langage du courtisan. C’est un des
traits du style Louis XIV, hérité du moyen âge (cf. Roman de la
Rose) et ravivé par la mythologie mise à la mode par la Renaissance.
c) Alliance de mots. Cette figure consiste à réunir deux mots
qui semblent n’avoir pas de rapport entre eux. C’est souvent une
forme de l’antithèse :
Elle part, elle s’évertue,
Elle se hâte avec lenteur. (VI, 10, 21-22.)
Cette alliance de mots est de plus une allusion au proverbe latin :
Festina lente (hâte-toi lentement).