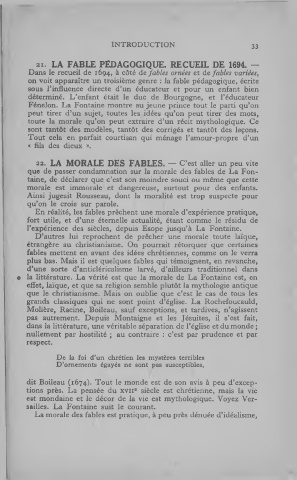Page 37 - Les fables de Lafontaine
P. 37
INTRODUCTION 33
21. LA FABLE PÉDAGOGIQUE. RECUEIL DE 1694. —
Dans le recueil de 1694, à côté de fables ornées et de fables variées,
on voit apparaître un troisième genre : la fable pédagogique, écrite
sous l’influence directe d’un éducateur et pour un enfant bien
déterminé. L’enfant était le duc de Bourgogne, et l’éducateur
Fénelon. La Fontaine montre au jeune prince tout le parti qu’on
peut tirer d’un sujet, toutes les idées qu’on peut tirer des mots,
toute la morale qu’on peut extraire d’un récit mythologique. Ce
sont tantôt des modèles, tantôt des corrigés et tantôt des leçons.
Tout cela en parfait courtisan qui ménage l’amour-propre d’un
« fils des dieux ».
22. LA MORALE DES FABLES. — C’est aller un peu vite
que de passer condamnation sur la morale des fables de La Fon
taine, de déclarer que c’est son moindre souci ou même que cette
morale est immorale et dangereuse, surtout pour des enfants.
Ainsi jugeait Rousseau, dont la moralité est trop suspecte pour
qu’on le croie sur parole.
En réalité, les fables prêchent une morale d’expérience pratique,
fort utile, et d’une éternelle actualité, étant comme lé résidu de
l’expérience des siècles, depuis Esope jusqu’à La Fontaine.
D’autres lui reprochent de prêcher une morale toute laïque,
étrangère au christianisme. On pourrait rétorquer que certaines
fables mettent en avant des idées chrétiennes, comme on le verra
plus bas. Mais il est quelques fables qui témoignent, en revanche,
d’une sorte d’anticléricalisme larvé, d’ailleurs traditionnel dans
• la littérature. La vérité est que la morale de La Fontaine est, en
effet, laïque, et que sa religion semble plutôt la mythologie antique
que le christianisme. Mais on oublie que c’est le cas de tous les
grands classiques qui ne sont point d’église. La Rochefoucauld,
Molière, Racine, Boileau, sauf exceptions, et tardives, n’agissent
pas autrement. Depuis Montaigne et les Jésuites, il s’est fait,
dans la littérature, une véritable séparation de l’église et du monde ;
nullement par hostilité ; au contraire : c’est par prudence et par
respect.
De la foi d’un chrétien les mystères terribles
D’ornements égayés ne sont pas susceptibles,
dit Boileau (1674). Tout le monde est de son avis à peu d’excep
tions près. La pensée du XVIIe siècle est chrétienne, mais la vie
est mondaine et le décor de la vie est mythologique. Voyez Ver
sailles. La Fontaine suit le courant.
La morale des fables est pratique, à peu près dénuée d’idéalisme,