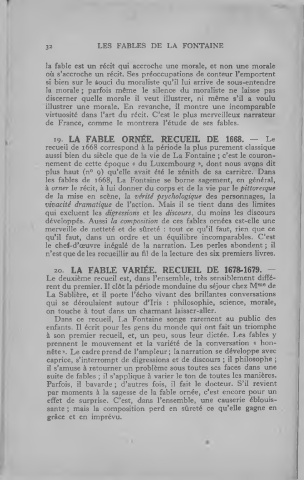Page 36 - Les fables de Lafontaine
P. 36
32 LES FABLES DE LA FONTAINE
la fable est un récit qui accroche une morale, et non une morale
où s’accroche un récit. Ses préoccupations de conteur l’emportent
si bien sur le Souci du moraliste qu’il lui arrive de sous-entendre
la morale ; parfois même le silence du moraliste ne laisse pas
discerner quelle morale il veut illustrer, ni même s’il a voulu
illustrer une morale. En revanche, il montre une incomparable
virtuosité dans l’art du récit. C’est le plus merveilleux narrateur
de France, comme le montrera l’étude de ses fables.
i9- LA FABLE ORNÉE. RECUEIL DE 1668. — Le
recueil de 1668 correspond à la période la plus purement classique
aussi bien du siècle que de la vie de La Fontaine ; c’est le couron
nement de cette époque « du Luxembourg », dont nous avons dit
plus haut (n° 9) qu’elle avait été le zénith de sa carrière. Dans
ies fables de 1668, La Fontaine se borne sagement, en général,
à orner le récit, à lui donner du corps et de la vie par le pittoresque
de la mise en scène, la vérité psychologique des personnages, la
vivacité dramatique de l’action. Mais il se tient dans des limites
qui excluent les digressions et les discours, du moins les discours
développés. Aussi la composition de ces fables ornées est-elle une
merveille de netteté et de sûreté : tout ce qu’il faut, rien que ce
qu’il faut, dans un ordre et un équilibre incomparables. C’est
le chef-d’œuvre inégalé de la narration. Les perles abondent ; il
n’est que de les recueillir au fil de la lecture des six premiers livres.
20. LA FABLE VARIÉE. RECUEIL DE 1678-1679. —
Le deuxième recueil est, dans l’ensemble, très sensiblement diffé
rent du premier. Il clôt la période mondaine du séjour chez Mme de
La Sablière, et il porte l’écho vivant des brillantes conversations
qui se déroulaient autour d’iris : philosophie, science, morale,
on touche à tout dans un charmant laisser-aller.
Dans ce recueil, La Fontaine songe rarement au public des
enfants. Il écrit pour les gens du monde qui ont fait un triomphe
à son premier recueil, et, un peu, sous leur dictée. Les fables y
prennent le mouvement et la variété de la conversation « hon
nête ». Le cadre prend de l’ampleur ; la narration se développe avec
caprice, s’interrompt de digressions et de discours ; il philosophe ;
il s’amuse à retourner un problème sous toutes ses faces dans une
suite de fables ; il s’applique à varier le ton de toutes les manières.
Parfois, il bavarde ; d’autres fois, il fait le docteur. S’il revient
par moments à la sagesse de la fable ornée, c’est encore pour un
effet de surprise. C’est, dans l’ensemble, une causerie éblouis
sante ; mais la composition perd en sûreté ce qu’elle gagne en
grâce et en imprévu.