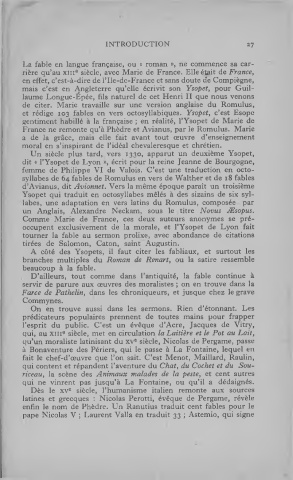Page 31 - Les fables de Lafontaine
P. 31
INTRODUCTION 27
La fable en langue française, ou « roman », ne commence sa car
rière qu’au xme siècle, avec Marie de France. Elle était de France,
en effet, c’est-à-dire de l’Ile-de-France et sans doute de Compiègne,
mais c’est en Angleterre qu’elle écrivit son Ysopet, pour Guil
laume Longue-Épée, fils naturel de cet Henri II que nous venons
de citer. Marie travaille sur une version anglaise du Romulus,
et rédige 103 fables en vers octosyllabiques. Ysopet, c’est Esope
gentiment habillé à la française ; en réalité, l’Ysopet de Marie de
France ne remonte qu’à Phèdre et Avianus, par le Romulus. Marie
a de la grâce, mais elle fait avant tout œuvre d’enseignement
moral en s’inspirant de l’idéal chevaleresque et chrétien.
Un siècle plus tard, vers 1330, apparut un deuxième Ysopet,
dit « l’Ysopet de Lyon », écrit pour la reine Jeanne de Bourgogne,
femme de Philippe VI de Valois. C’est une traduction en octo
syllabes de 64 fables de Romulus en vers de Walther et de 18 fables
d’Avianus, dit Avionnet. Vers la même époque paraît un troisième
Ysopet qui traduit en octosyllabes mêlés à des sizains de six syl
labes, une adaptation en vers latins du Romulus, composée par
un Anglais, Alexandre Neckam, sous le titre Novus Æsopus.
Comme Marie de France, ces deux auteurs anonymes se pré
occupent exclusivement de la morale, et l’Ysopet de Lyon fait
tourner la fable au sermon prolixe, avec abondance de citations
tirées de Salomon, Caton, saint Augustin.
A côté des Ysopets, il faut citer les fabliaux, et surtout les
branches multiples du Roman de Renart, ou la satire ressemble
beaucoup à la fable.
D’ailleurs, tout comme dans l’antiquité, la fable continue à
servir de parure aux œuvres des moralistes ; on en trouve dans la
Farce de Pathelin, dans les chroniqueurs, et jusque chez le grave
Commynes.
On en trouve aussi dans les sermons. Rien d’étonnant. Les
prédicateurs populaires prennent de toutes mains pour frapper
l’esprit du public. C’est un évêque d’Acre, Jacques de Vitry,
qui, au xine siècle, met en circulation la Laitière et le Pot au Lait,
qu’un moraliste latinisant du XVe siècle, Nicolas de Pergame, passe
à Bonaventure des Périers, qui le passe à La Fontaine, lequel en
fait le chef-d’œuvre que l’on sait. C’est Menot, Maillard, Raulin,
qui content et répandent l’aventure du Chat, du Cochet et du Sou
riceau, la scène des Animaux malades de la peste, et cent autres
qui ne vinrent pas jusqu’à La Fontaine, ou qu’il a dédaignés.
Dès le xve siècle, l’humanisme italien remonte aux sources
latines et grecques : Nicolas Perotti, évêque de Pergame, révèle
enfin le nom de Phèdre. Un Ranutius traduit cent fables pour le
pape Nicolas V ; Laurent Valla en traduit 33 ; Astemio, qui signe