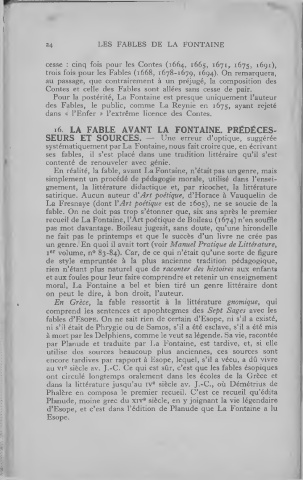Page 28 - Les fables de Lafontaine
P. 28
I
I
24 LES FABLES DE LA FONTAINE
cesse : cinq fois pour les Contes (1664, 1665, 1671, 1675, 1691),
trois fois pour les Fables (1668, 1678-1679, 1694). On remarquera,
au passage, que contrairement à un préjugé, la composition des
Contes et celle des Fables sont allées sans cesse de pair.
Pour la postérité, La Fontaine est presque uniquement l’auteur
des Fables, le public, comme La Reynie en 1675, ayant rejeté
dans « l’Enfer » l’extrême licence des Contes.
16. LA FABLE AVANT LA FONTAINE. PRÉDÉCES
SEURS ET SOURCES. — Une erreur d’optique, suggérée
■ . systématiquement par La Fontaine, nous fait croire que, en écrivant
ses fables, il s’est placé dans une tradition littéraire qu’il s’est
contenté de renouveler avec génie.
En réalité, la fable, avant La Fontaine, n’était pas un genre, mais
simplement un procédé de pédagogie morale, utilisé dans l’ensei
gnement, la littérature didactique et, par ricochet, la littérature
satirique. Aucun auteur d’Art poétique, d’Horace à Vauquelin de
La Fresnaye (dont VArt poétique est de 1605), ne se soucie de la
fable. On ne doit pas trop s’étonner que, six ans après le premier
recueil de La Fontaine, l’Art poétique de Boileau (1674) n’en souffle
pas mot davantage. Boileau jugeait, sans doute, qu’une hirondelle
ne fait pas le printemps et que le succès d’un livre ne crée pas
un genre. En quoi il avait tort (voir Manuel Pratique de Littérature,
Ier volume, n° 83-84). Car, de ce qui n’était qu’une sorte de figure
de style empruntée à la plus ancienne tradition pédagogique,
rien n’étant plus naturel que de raconter des histoires aux enfants
et aux foules pour leur faire comprendre et retenir un enseignement
moral, La Fontaine a bel et bien tiré un genre littéraire dont
on peut le dire, à bon droit, l’auteur.
. En Grèce, la fable ressortit à la littérature gnomique, qui
comprend les sentences et apophtegmes des Sept Sages avec les
fables d’EsoPE. On ne sait rien de certain d’Esope, ni s’il a existé,
ni s’il était de Phrygie ou de Samos, s’il a été esclave, s’il a été mis
à mort par les Delphiens, comme le veut sa légende. Sa vie, racontée
par Planude et traduite par La Fontaine, est tardive, et, si elle
utilise des sources beaucoup plus anciennes, ces sources sont
encore tardives par rapport à Esope, lequel, s’il a vécu, a dû vivre
au VIe siècle av. J.-C. Ce qui est sûr, c’est que les fables ésopiques
ont circulé longtemps oralement dans les écoles de la Grèce et
dans la littérature jusqu’au IVe siècle av. J.-C., où Démétrius de
Phalère en composa le premier recueil. C’est ce recueil qu’édita
Planude, moine grec du xive siècle, en y joignant la vie légendaire
d’Esope, et c’est dans l’édition de Planude que La Fontaine a lu
Esope.