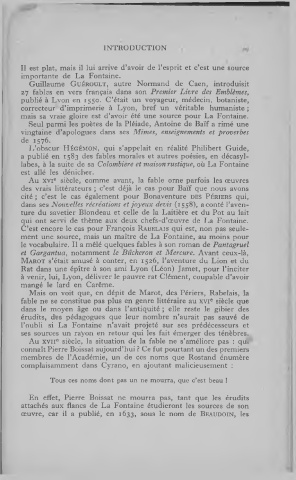Page 33 - Les fables de Lafontaine
P. 33
INTRODUCTION
Il est plat, mais il lui arrive d’avoir de l’esprit et c’est une source
importante de La Fontaine.
Guillaume Guéroult, autre Normand de Caen, introduisit
27 fables en vers français dans son Premier Livre des Emblèmes,
publié à Lvon en 1550. C’était un voyageur, médecin, botaniste,
correcteur d’imprimerie à Lyon, bref un véritable humaniste;
mais sa vraie gloire est d’avoir été une source pour La Fontaine.
Seul parmi les poètes de la Pléiade, Antoine de Baïf a rimé une
vingtaine d’apologues dans ses Mimes, enseignements et proverbes
de 1576.
L’obscur Hégémon, qui s’appelait en réalité Philibert Guide,
a publié en 1583 des fables morales et autres poésies, en décasyl
labes, à la suite de sa Colombiere et maison rustique, où La Fontaine
est allé les dénicher.
Au XVIe siècle, comme avant, la fable orne parfois les œuvres
des vrais littérateurs ; c’est déjà le cas pour Baïf que nous avons
cité ; c’est le cas également pour Bonaventure des Périers qui,
dans ses Nouvelles récréations et joyeux devis (1558), aconté l’aven
ture du savetier Blondeau et celle de la Laitière et du Pot au lait
qui ont servi de thème aux deux chefs-d’œuvre de La Fontaine.
C’est encore le cas pour François Rabelais qui est, non pas seule
ment une source, mais un maître de La Fontaine, au moins pour
le vocabulaire. Il a mêlé quelques fables à son roman de Pantagruel
et Gargantua, notamment le Bûcheron et Mercure. Avant ceux-là,
Marot s’était amusé à conter, en 1526, l’aventure du Lion et du
Rat dans une épître à son ami Lyon (Léon) Jamet, pour l’inciter
à venir, lui, Lyon, délivrer le pauvre rat Clément, coupable d’avoir
mangé le lard en Carême.
Mais on voit que, en dépit de Marot, des Périers, Rabelais, la
fable ne se constitue pas plus en genre littéraire au XVIe siècle que
dans le moyen âge ou dans l’antiquité ; elle reste le gibier des
érudits, dès pédagogues que leur nombre n’aurait pas sauvé de
l’oubli si La Fontaine n’avait projeté sur ses prédécesseurs et
ses sources un raÿon en retour qui les fait émerger des ténèbres.
Au xviie siècle, la situation de la fable ne s’améliore pas : qui
connaît Pierre Boissat aujourd’hui ? Ce fut pourtant un des premiers
membres de l’Académie, un de ces noms que Rostand énumère
complaisamment dans Cyrano, en ajoutant malicieusement :
Tous ces noms dont pas un ne mourra, que c’est beau !
En effet, Pierre Boissat ne mourra pas, tant que les érudits
attachés aux flancs de La Fontaine étudieront les sources de son
œuvre, car il a publié, en 1633, sous le nom de Beaudoin, les