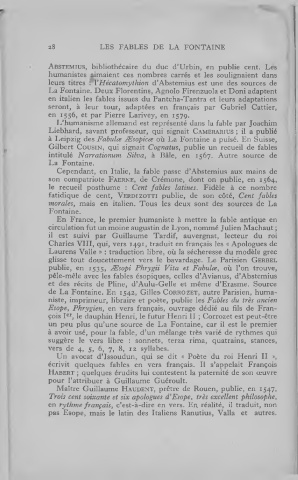Page 32 - Les fables de Lafontaine
P. 32
28 LES FABLES DE LA FONTAINE
Abstemius, bibliothécaire du duc d’Urbin, en publie cent. Les
humanistes aimaient ces nombres carrés et les soulignaient dans
leurs titres : V Hécatomythion d’Abstemius est une des sources de
La Fontaine. Deux Florentins, Agnolo Firenzuola et Doni adaptent
en italien les fables issues du Pantcha-Tantra et leurs adaptations
seront, à leur tour, adaptées en français par Gabriel Cattier,
en 1556, et par Pierre Larivey, en 1579.
L’humanisme allemand est représenté dans la fable par Joachim
Liebhard, savant professeur, qui signait Camerarius ; il a publié
à Leipzig des Fabulce Æsopicce où La Fontaine a puisé. En Suisse,
Gilbert Cousin, qui signait Cognatus, publie un recueil de fables
intitulé Narrationum Silva, à Bâle, en 1567. Autre source de
La Fontaine.
Cependant, en Italie, la fable passe d’Abstemius aux mains de
son compatriote Faerne, de Crémone, dont on publie, en 1564,
le recueil posthume : Cent fables latines. Fidèle à ce nombre
fatidique de cent, Verdi zotti publie, de son côté, Cent fables
morales, mais en italien. Tous les deux sont des sources de La
Fontaine.
En France, le premier humaniste à mettre la fable antique en
circulation fut un moine augustin de Lyon, nommé Julien Machaut ;
il est suivi par Guillaume Tardif, auvergnat, lecteur du roi
Charles VIII, qui, vers 1491, traduit en français les « Apologues de
Laurens Valle » : traduction libre, où la sécheresse du modèle grec
glisse tout doucettement vers le bavardage. Le Parisien Gerbel
publie, en 1535, Æsopi Phrygii Vita et Fabulce, où l’on trouve,
pêle-mêle avec les fables ésopiques, celles d’Avianus, d’Abstemius
et des récits de Pline, d’Aulu-Gelle et même d’Erasme. Source
de La Fontaine. En 1542, Gilles-Corrozet, autre Parisien, huma
niste, imprimeur, libraire et poète, publie les Fables du très ancien
Esope, Phrygien, en vers français, ouvrage dédié au fils de Fran
çois Ier, le dauphin Henri, le futur Henri II ; Corrozet est peut-être
un peu plus qu’une source de La Fontaine, car il est le premier
à avoir usé, pour la fable, d’un mélange très varié de rythmes qui
suggère le vers libre : sonnets, terza rima, quatrains, stances,
vers de 4, 5, 6, 7, 8, 12 syllabes.
Un avocat d’Issoudun, qui se dit « Poète du roi Henri II »,
écrivit quelques fables en vers français. Il s’appelait François
Habert ; quelques érudits lui contestent la paternité de son œuvre
pour l’attribuer à Guillaume Guéroult.
Maître Guillaume Haudent, prêtre de Rouen, publie, en 1547,
Trois cent soixante et six apologues d’Esope, très excellent philosophe,
en rythme français, c’est-à-dire en vers. En réalité, il traduit, non
pas Esope, mais le latin des Italiens Ranutius, Valla et autres.