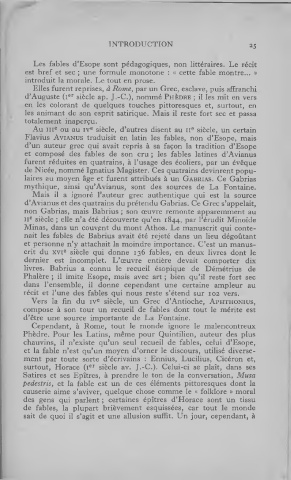Page 29 - Les fables de Lafontaine
P. 29
INTRODUCTION 25
Les fables d’Esope sont pédagogiques, non littéraires. Le récit
est bref et sec ; une formule monotone : « cette fable montre... »
introduit la morale. Le tout en prose.
Elles furent reprises, à Rome, par un Grec, esclave, puis affranchi
d’Auguste (ier siècle ap. J.-C.), nommé Phèdre ; il les mit en vers
en les colorant de quelques touches pittoresques et, surtout, en
les animant de son esprit satirique. Mais il reste fort sec et passa
totalement inaperçu.
Au IIIe ou au ive siècle, d’autres disent au 11e siècle, un certain
Flavius Avianus traduisit en latin les fables, non d’Esope, mais
d’un auteur grec qui avait repris à sa façon la tradition d’Esope
et composé des fables de son cru ; les fables latines d’Avianus
furent réduites en quatrains, à l’usage des écoliers, par un évêque
de Nicée, nommé Ignatius Magister. Ces quatrains devinrent popu
laires au moyen âge et furent attribués à un Gabrias. Ce Gabrias
mythique, ainsi qu’Avianus, spnt des sources de La Fontaine.
Mais il a ignoré l’auteur grec authentique qui est la source
d’Avianus et des quatrains du prétendu Gabrias. Ce Grec s’appelait,
non Gabrias, mais Babrius ; son œuvre remonte apparemment au
11e siècle.; elle n’a été découverte qu’en 1844, par l’érudit Minoïde
Minas, dans un couvpnt du mont Athos. Le manuscrit qui conte
nait les fables de Babrius avait été rejeté dans un lieu dégoûtant
et personne n’y attachait la moindre importance. C’est un manus
crit du xvie siècle qui donne 136 fables, en deux livres dont le
dernier est incomplet. L’œuvre entière devait comporter dix
livres. Babrius a connu le recueil ésopique de Démétrius de
Phalère ; il imite Esope, mais avec art ; bien qu’il reste fort sec
dans l’ensemble, il donne cependant une certaine ampleur au
récit et l’une des fables qui nous reste s’étend sur 102 vers.
Vers la fin du IVe siècle, un Grec d’Antioche, Aphthonius,
compose à son tour un recueil de fables dont tout le mérite est
d’être une source importante de La Fontaine.
Cependant, à Rome, tout le monde ignore le malencontreux
Phèdre. Pour les Latins, même pour Quintilien, auteur des plus
chauvins, il n’existe qu’un seul recueil de fables, celui d’Esope,
et la fable n’est qu’un moyen d’orner le discours, utilisé diverse
ment par toute sorte d’écrivains : Ennius, Lucilius, Cicéron et,
surtout, Horace (ier siècle av. J.-C.). Celui-ci se plaît, dans ses
Satires et ses Epîtres, à prendre le ton de la conversation, Musa
pedestris, et la fable est un de ces éléments pittoresques dont la
causerie aime s’aviver, quelque chose comme le « folklore » moral
des gens qui parlent ; certaines épîtres d’Horace sont un tissu
de fables, la plupart brièvement esquissées, car tout le monde
sait de quoi il s’agit et une allusion suffit. Un jour, cependant, à