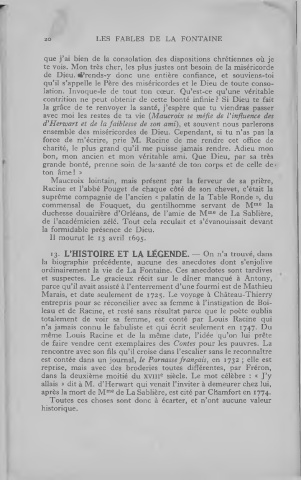Page 24 - Les fables de Lafontaine
P. 24
20 LES FABLES DE LA FONTAINE
que j’ai bien de la consolation des dispositions chrétiennes où je
te vois. Mon très cher, les plus justes ont besoin de la miséricorde
de Dieu, «frends-y donc une entière confiance, et souviens-toi
qu’il s’appelle le Père des miséricordes et le Dieu de toute conso
lation. Invoque-le de tout ton cœur. Qu’est-ce qu’une véritable
contrition ne peut obtenir de cette bonté infinie ? Si Dieu te fait
la grâce de te renvoyer la santé, j’espère que tu viendras passer
avec moi les restes de ta vie {Maucroix se méfie de l’influence des
d’Heruiart et de la faiblesse de son ami), et souvent nous parlerons
ensemble des miséricordes de Dieu. Cependant, si tu n’as pas la
force de m’écrire, prie M. Racine de me rendre cet office de
charité, le plus grand qu’il me puisse jamais rendre. Adieu mon
bon, mon ancien et mon véritable ami. Que Dieu, par sa très
grande bonté, prenne soin de la' santé de ton corps et de celle de •
ton âme ! »
Maucroix lointain, mais présent par la ferveur de sa prière,
Racine et l’abbé Pouget de chaque côté de son chevet, c’était la
suprême compagnie de l’ancien « palatin de la Table Ronde », du
commensal de Fouquet, du gentilhomme servant de Mme la
duchesse douairière d’Orléans, de l’amie de Mme de La Sablière,
de l’académicien zélé. Tout cela reculait et s’évanouissait devant
la formidable présence de Dieu.
Il mourut le 13 avril 1695.
13. L’HISTOIRE ET LA LÉGENDE. — On n’a trouvé, dans
la biographie précédente, aucune des anecdotes dont s’enjolive
ordinairement la vie de La Fontaine. Ces anecdotes sont tardives
et suspectes. Le gracieux récit sur le dîner manqué à Antony,
parce qu’il avait assisté à l’enterrement d’une fourmi est de Mathieu
Marais, et date seulement de 1725. Le voyage à Château-Thierry
entrepris pour se réconcilier avec sa femme à l’instigation de Boi
leau et de Racine, et resté sans résultat parce que le poète oublia
totalement de voir sa femme, est conté par Louis Racine qui
n’a jamais connu le fabuliste et qui écrit seulement en 1747. Du
même Louis Racine et de la même date, l’idée qu’on lui prête
de faire vendre cent exemplaires des Contes pour les pauvres. La
rencontre avec son fils qu’il croise dans l’escalier sans le reconnaître
est contée dans un journal, le Parnasse français, en 1732 ; elle est
reprise, mais avec des broderies toutes différentes, par Fréron,
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le mot célèbre : « J’y
allais » dit à M. d’Herwart qui venait l’inviter à demeurer chez lui,
après la mort de Mme de La Sablière, est cité par Chamfort en 1774.
Toutes ces choses sont donc à écarter, et n’ont aucune valeur
historique.