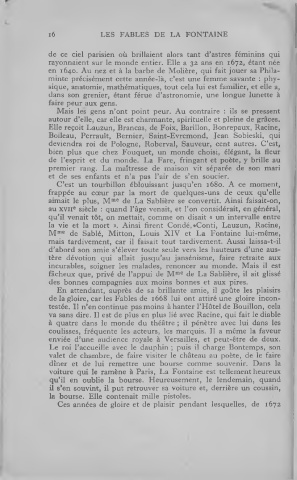Page 20 - Les fables de Lafontaine
P. 20
i6 LES FABLES DE LA FONTAINE
de ce ciel parisien où brillaient alors tant d’astres féminins qui
rayonnaient sur le monde entier. Elle a 32 ans en 1672, étant née
en 1640. Au nez et à la barbe de Molière, qui fait jouer sa Phila-
minte précisément cette année-là, c’est une femme savante : phy
sique, anatomie, mathématiques, tout cela lui est familier, et elle a,
dans son grenier, étant férue d’astronomie, une longue lunette à
faire peur aux gens.
Mais les gens n’ont point peur. Au contraire : ils se pressent
autour d’elle, car elle est charmante, spirituelle et pleine de grâces.
Elle reçoit Lauzun, Brancas, de Foix, Barillon, Bonrepaux, Racine,
Boileau, Perrault, Bernier, Saint-Evremond, Jean Sobieski, qui
deviendra roi de Pologne, Roberval, Sauveur, cent autres. C’est,
bien plus que chez Fouquet, un monde choisi, élégant, la fleur
de l’esprit et du monde. La Fare, fringant et poète, y brille au
premier rang. La maîtresse de maison vit séparée de son mari
et de ses enfants et n’a pas l’air de s’én soucier.
C’est un tourbillon éblouissant jusqu’en 1680. A ce moment,
frappée au cœur par la mort de quelques-uns de ceux qu’elle
aimait le plus, Mme de La Sablière se convertit. Ainsi faisait-on,
au XVIIe siècle : quand l’âge venait, et l’on considérait, en général,
qu’il venait tôt, on mettait, comme on disait « un intervalle entre
la vie et la mort ». Ainsi firent Condé, «Conti, Lauzun, Racine,
Mme de Sablé, Mitton, Louis XIV et La Fontaine lui-même,
mais tardivement, car il faisait tout tardivement. Aussi laissa-t-il
d’abord son amie s’élever toute seule vers les hauteurs d’une aus
tère dévotion qui allait jusqu’au jansénisme, faire retraite aux
incurables, soigner les malades, renoncer au monde. Mais il est
fâcheux que, privé de l’appui de Mme de La Sablière, il ait glissé
des bonnes compagnies aux moins bonnes et aux pires.
En attendant, auprès de sa brillante amie, il goûte les plaisirs
de la gloire, car les Fables de 1668 lui ont attiré une gloire incon
testée. Il n’en continue pas moins à hanter l’Hôtelde Bouillon, cela
va sans dire. Il est de plus en plus lié avec Racine, qui fait le diable
à quatre dans le monde du théâtre ; il pénètre avec lui dans les
coulisses, fréquente les acteurs, les marquis. Il a même la faveur
enviée d’une audience royale à Versailles, et peut-être de deux.
Le roi l’accueille avec le dauphin ; puis il charge Bontemps, son
valet de chambre, de faire visiter le château au poète, de le faire
dîner et de lui remettre une bourse comme souvenir. Dans la
voiture qui le ramène à Paris, La Fontaine est tellement heureux
qu’il en oublie la bourse. Heureusement, le lendemain, quand
il s’en souvint, il put retrouver sa voiture et, derrière un coussin,
la bourse. Elle contenait mille pistoles.
Ces années de gloire et de plaisir pendant lesquelles, de 1672