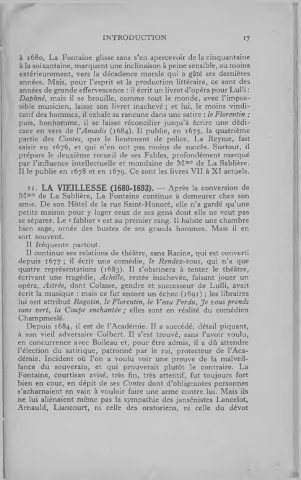Page 21 - Les fables de Lafontaine
P. 21
INTRODUCTION >7
à 1680, La Fontaine glisse sans s’en apercevoir de la cinquantaine
à la soixantaine, marquent une inclinaison à peine sensible, au moins
extérieurement, vers la décadence morale qui a gâté ses dernières
années. Mais, pour l’esprit et la production littéraire, ce sont des
années de grande effervescence : il écrit un livret d’opéra pour Lulli :
Daphné, mais il se brouille, comme tout le monde, avec l’impos
sible musicien, laisse son livret inachevé ; et lui, le moins vindi
catif des hommes, il exhale sa rancune dans une satire : le Florentin ;
puis, bonhomme, il se laisse réconcilier jusqu’à écrire une dédi
cace en vers de VAmadis (1684). Il publie, en 1675, la quatrième
partie des Contes, que le lieutenant de police, La Reynie, fait
saisir en 1676, et qui n’en ont pas moins de succès. Surtout, il
prépare le deuxième recueil de ses Fables, profondément marqué
par l’influence intellectuelle et mondaine de Mme de La Sablière.
Il le publie en 1678 et en 1679. Ce sont les livres VII à XI actuels.
11. LA VIEILLESSE (1680'1693). — Après la conversion de
Mme de La Sablière, La Fontaine continue à demeurer chez son
amie. De son Hôtel de la rue Saint-Honoré, elle n’a gardé qu’une
petite maison pour y loger ceux de ses gens dont elle ne veut pas
se séparer. Le « fablier » est au premier rang. Il habite une chambre
bien sage, ornée des bustes de ses grands hommes. Mais il en
sort souvent.
Il fréquente partout.
Il continue ses relations de théâtre, sans Racine, qui est converti
depuis 1677 ; il écrit une comédie, le Rendez-vous, qui n’a que
quatre représentations (1683). Il s’obstinera à tenter le théâtre,
écrivant une tragédie, Achille, restée inachevée, faisant jouer un
opéra, Astrée, dont Colasse, gendre et successeur de Lulli, avait
écrit la musique : mais ce fut encore un échec (1691) ; les libraires
lui ont attribué Ragotin, le Florentin, le Veau Perdu, Je vous prends
sans vert, la Coupe enchantée ; elles sont en réalité du comédien
Champmeslé.
Depuis 1684, il est de l’Académie. Il a succédé, détail piquant,
à son vieil adversaire Colbert. Il s’est trouvé, sans l’avoir voulu,
en concurrence avec Boileau et, pour être admis, il a dû attendre
l’élection du satirique, patronné par le roi, protecteur de l’Aca
démie. Incident où l’on a voulu voir une preuve de la malveil
lance du souverain, et qui prouverait plutôt le contraire. La
Fontaine, courtisan avisé, très fin, très attentif, fut toujours fort
bien en cour, en dépit de ses Contes dont d’obligeantes personnes
s’acharnaient en vain à vouloir faire une arme contre lui. Mais ils
ne lui aliénaient même pas la sympathie des jansénistes Lancelot,
Arnauld, Liancourt, ni celle des oratoriens, ni celle du dévot