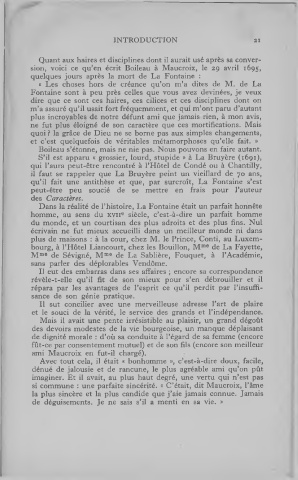Page 25 - Les fables de Lafontaine
P. 25
INTRODUCTION 21
Quant aux haires et disciplines dont il aurait usé après sa conver
sion, voici ce qu’en écrit Boileau à Maucroix, le 29 avril 1695,
quelques jours après la mort de La Fontaine :
« Les choses hors de créance qu’on m’a dites de M. de La
Fontaine sont à peu près celles que vous avez devinées, je veux
dire que ce sont ces haires, ces cilices et ces disciplines dont on
m’a assuré qu’il usait fort fréquemment, et qui m’ont paru d’autant
plus incroyables de notre défunt ami que jamais rien, à mon avis,
ne fut plus éloigné de son caractère que ces mortifications. Mais
quoi ? la grâce de Dieu ne se borne pas aux simples changements,
et c’est quelquefois de véritables métamorphoses qu’elle fait. »
Boileau s’étonne, mais ne nie pas. Nous pouvons en faire autant.
S’il est apparu « grossier, lourd, stupide » à La Bruyère (1691),
qui l’aura peut-être rencontré à l’Hôtel de Condé ou à Chantilly,
il faut se rappeler que La Bruyère peint un vieillard de 70 ans,
qu’il fait une antithèse et que, par surcroît, La Fontaine s’est
peut-être peu soucié de se mettre en frais pour Fauteur
des Caractères.
Dans la réalité de l’histoire, La Fontaine était un parfait honnête
homme, au sens du xvnc siècle, c’est-à-dire un parfait homme
du monde, et un courtisan des plus adroits et des plus fins. Nul
écrivain ne fut mieux accueilli dans un meilleur monde ni dans
plus de maisons : à la cour, chez M. le Prince, Conti, au Luxem
bourg, à l’Hôtel Liancourt, chez les Bouillon, Mme de La Fayette,
Mme de Sévigné, Mme de La Sablière, Fouquet, à l’Académie,
sans parler des déplorables Vendôme.
Il eut des embarras dans ses affaires ; encore sa correspondance
révèle-t-elle qu’il fit de son mieux pour s’en débrouiller et il
répara par les avantages de l’esprit ce qu’il perdit par l’insuffi
sance de son génie pratique.
Il sut concilier avec une merveilleuse adresse l’art de plaire
et le souci de la vérité, le service des grands et l’indépendance.
Mais il avait une pente irrésistible au plaisir, un grand dégoût
des devoirs modestes de la vie bourgeoise, un manque déplaisant
de dignité morale : d’où sa conduite à l’égard de sa femme (encore
fût-ce par consentement mutuel) et de son fils (encore son meilleur
ami Maucroix en fut-il chargé).
Avec tout cela, il était « bonhomme », c’est-à-dire doux, facile,
dénué de jalousie et de rancune, le plus agréable ami qu’on pût
imaginer. Et il avait, au plus haut degré, une vertu qui n’est pas
si commune : une parfaite sincérité. « C’était, dit Maucroix, l’âme
la plus sincère et la plus candide que j’aie jamais connue. Jamais
de déguisements. Je ne sais s’il a menti en sa vie. »