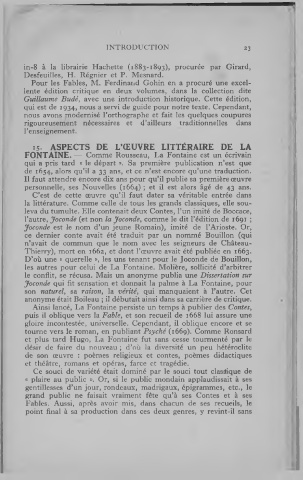Page 27 - Les fables de Lafontaine
P. 27
INTRODUCTION 23
in-8 à la librairie Hachette (1883-1893), procurée par Girard,
Desfeuilles, H. Régnier et P. Mesnard.
Pour les Fables, M. Ferdinand Gohin en a procuré une excel
lente édition critique en deux volumes, dans la collection dite
Guillaume Budé, avec une introduction historique. Cette édition,
qui est de 1934, nous a servi de guide pour notre texte. Cependant,
nous avons modernisé l’orthographe et fait les quelques coupures
rigoureusement nécessaires et d’ailleurs traditionnelles dans
l’enseignement.
15. ASPECTS DE L’ŒUVRE LITTÉRAIRE DE LA
FONTAINE. •—• Comme Rousseau, La Fontaine est un écrivain
qui a pris tard « le départ ». Sa première publication n’est que
de 1654, alors qu’il a 33 ans, et ce n’est encore qu’une traduction.
Il faut attendre encore dix ans pour qu’il publie sa première œuvre
personnelle, ses Nouvelles (1664) ; et il est alors âgé de 43 ans.
C’est de cette œuvre qu’il faut dater sa véritable entrée dans
la littérature. Comme celle de tous les grands classiques, elle sou
leva du tumulte. Elle contenait deux Contes, l’un imité de Boccace,
l’autre, Joconde (et non la Joconde, comme le dit l’édition de 1691 ;
Joconde est le nom d’un jeune Romain), imité de l’Arioste. Or,
ce dernier conte avait été traduit par un nommé Bouillon (qui
n’avait de commun que le nom avec les seigneurs de Château-
Thierry), mort en 1662, et dont l’œuvre avait été publiée en 1663.
D’où une « querelle », les uns tenant pour le Joconde de Bouillon,
les autres pour celui de La Fontaine. Molière, sollicité d’arbitrer
le conflit, se récusa. Mais un anonyme publia une Dissertation sur
Joconde qui fit sensation et donnait la palme à La Fontaine, pour
son naturel, sa raison, la vérité, qui manquaient à l’autre. Cet
anonyme était Boileau ; il débutait ainsi dans sa carrière de critique.
Ainsi lancé, La Fontaine persiste un temps à publier des Contes,
puis il oblique vers la Fable, et son recueil de 1668 lui assure une
gloire incontestée, universelle. Cependant, il oblique encore et se
tourne vers le roman, en publiant Psyché (1669). Comme Ronsard
et plus tard Hugo, La Fontaine fut sans cesse tourmenté par le
désir de faire du nouveau ; d’où la diversité un peu hétéroclite
de son œuvre : poèmes religieux et contes, poèmes didactiques
et théâtre, romans et opéras, farce et tragédie.
Ce souci de variété était dominé par le souci tout classique de
« plaire au public ». Or, si le public mondain applaudissait à ses
gentillesses d’un jour, rondeaux, madrigaux, épigrammes, etc., le
grand public ne faisait vraiment fête qu’à ses Contes et à ses
Fables. Aussi, après avoir mis, dans chacun de ses recueils, le
point final à sa production dans ces deux genres, y revint-il sans