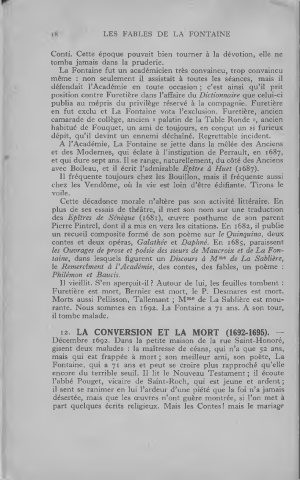Page 22 - Les fables de Lafontaine
P. 22
LES FABLES DE LA FONTAINE
Conti. Cette époque pouvait bien tourner à la dévotion, elle ne
tomba jamais dans la pruderie.
La Fontaine fut un académicien très convaincu, trop convaincu
même : non seulement il assistait à toutes les séances, mais il
défendait l’Académie en toute occasion ; c’est ainsi qu’il prit
position contre Furetière dans l’affaire du Dictionnaire que celui-ci
publia au mépris du privilège réservé à la compagnie. Furetière
en fut exclu et La Fontaine vota l’exclusion. Furetière, ancien
camarade de collège, ancien « palatin de la Table Ronde », ancien
habitué de Fouquet, un ami de toujours, en conçut un si furieux
dépit, qu’il devint un ennemi déchaîné. Regrettable incident.
A l’Académie, La Fontaine se jette dans la mêlée des Anciens
et des Modernes, qui éclate à l’instigation de Perrault, en 1687,
et qui dure sept ans. Il se range, naturellement, du côté des Anciens
avec Boileau, et il écrit l’admirable Epître à Huet (1687).
Il fréquente toujours chez les Bouillon, mais il fréquente aussi
chez les Vendôme, où la vie est loin d’être édifiante. Tirons le
voile.
Cette décadence morale n’altère pas son activité littéraire. En
plus de ses essais de théâtre, il met son nom sur une traduction
des Epîtres de Sénèque (1681), œuvre posthume de son parent
Pierre Pintrel, dont il a mis en vers les citations. En 1682, il publie
un recueil composite formé de son poème sur le Quinquina, deux
contes et deux opéras, Galathée et Daphné. En 1685, paraissent
les Ouvrages de prose et poésie des sieurs de Maucroix et de La Fon
taine, dans lesquels figurent un Discours à Mme de La Sablière,
le Remercîment à l’Académie, des contes, des fables, un poème :
Philémon et Baucis.
Il vieillit. S’en aperçoit-il ? Autour de lui, les feuilles tombent :
Furetière est mort, Bernier est mort, le P. Desmares est mort.
Morts aussi Pellisson, Tallemant ; Mme de La Sablière est mou
rante. Nous sommes en 1692. La Fontaine a 71 ans. A son tour,
il tombe malade.
12. LA CONVERSION ET LA MORT (1692-1695). —
Décembre 1692. Dans la petite maison de la rue Saint-Honoré,
gisent deux malades : la maîtresse de céans, qui n’a que 52 ans,
mais qui est frappée à mort ; son meilleur ami, son poète, La
Fontaine, qui a 71 ans et peut se croire plus rapproché qu’elle
encore du terrible seuil. Il lit le Nouveau Testament ; il écoute
l’abbé Pouget, vicaire de Saint-Roch, qui est jeune et ardent ;
il sent se ranimer en lui l’ardeur d’une piété que la foi n’a jamais
désertée, mais que les œuvres n’ont guère montrée, si l’on met à
part quelques écrits religieux. Mais les Contes! mais le mariage