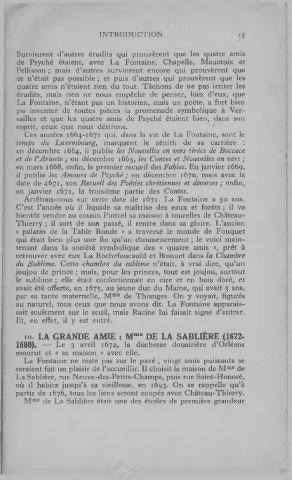Page 19 - Les fables de Lafontaine
P. 19
INTRODUCTION 5
Survinrent d’autres érudits qui prouvèrent que les quatre amis
de Psyché étaient, avec La Fontaine, Chapelle, Maucroix et
Pellisson ; mais d’autres survinrent encore qui prouvèrent que
ce n’était pas possible ; et puis d’autres qui prouvèrent que les
quatre amis n’étaient rien du tout. Tâchons de ne pas irriter les
érudits, mais rien ne nous empêche de penser, loin d’eux, que
La Fontaine, n’étant pas un historien, mais un poète, a fort bien
pu inventer de toutes pièces la promenade symbolique à Ver
sailles et que les quatre amis de Psyché étaient bien, dans son
esprit, ceux que nous désirons. '
Ces années 1664-1671 qui, dans la vie de La Fontaine, sont le
temps du Luxembourg, marquent le zénith de sa carrière :
en décembre 1664, il publie les Nouvelles en vers tirées de Boccace
et de l’Arioste ; en décembre 1665, les Contes et Nouvelles en vers ;
en mars 1668, enfin, le premier recueil des Fables. En janvier 1669,
il publie les Amours de Psyché ; en décembre 1670, mais avec la
date de 4671, son Recueil des Poésies chrétiennes et diverses ; enfin,
en janvier 1671, la troisième partie des Contes.
Arrêtons-nous sur cette date de 1671. La Fontaine a 50 ans.
C’est l’année où il liquide sa maîtrise des eaux et forêts ; il va
bientôt vendre au cousin Pintrel sa maison à tourelles de Château-
Thierry ; il sort de son passé, il rentre dans sa gloire. L’ancien
« palatin de la Table Ronde » a traversé le monde de Fouquet
qui était bien plus une fin qu’un commencement ; le voici main
tenant dans la société symbolique des « quatre amis », prêt à
retrouver avec eux La Rochefoucauld et Bossuet dans la Chambre
du Sublime. Cette chambre du sublime n’était, à vrai dire, qu’un
joujou de prince ; mais, pour les princes, tout est joujou, surtout
le sublime ; elle était confectionnée en cire et en bois doré, et
avait été offerte, en 1675, au jeune duc du Maine, qui avait 5 ans,
par sa tante maternelle, Mme de Thianges. On y voyait, figurés
au naturel, tous ceux que nous avons dit. La Fontaine apparais
sait seulement sur le seuil, mais Racine lui faisait signe d’entrer.
Et, en effet, il y est entré.
10. LA GRANDE AMIE : Mme DE LA SABLIÈRE (1672-
1680). — Le 3 avril 1672, la duchesse douairière d’Orléans
mourut et « sa maison » avec elle.
La Fontaine ne resté pas sur le pavé ; vingt amis puissants se
seraient fait un plaisir de l’accueillir. Il choisit la maison de Mme de
La Sablière, rue Neuve-des-Petits-Champs, puis rue Saint-Honoré,
où il habita jusqu’à sa vieillesse, en 1693. On se rappelle qu’à
partir de 1676, tous les liens seront coupés avec Château-Thierry.
Mme de La Sablière était une des étoiles de première grandeur