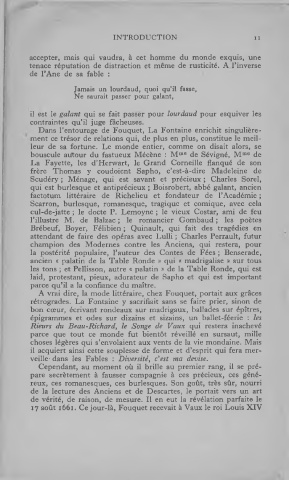Page 15 - Les fables de Lafontaine
P. 15
INTRODUCTION il
accepter, mais qui vaudra, à cet homme du monde exquis, une
tenace réputation de distraction et même de rusticité. A l’inverse
de l’Ane de sa fable :
Jamais un lourdaud, quoi qu’il fasse,
Ne saurait passer pour galant,
il est le galant qui se fait passer pour lourdaud pour esquiver les
contraintes qu’il juge fâcheuses.
Dans l’entourage de Fouquet, La Fontaine enrichit singulière
ment ce trésor de relations qui, de plus en plus, constitue le meil
leur de sa fortune. Le monde entier, comme on disait alors, se
bouscule autour du fastueux Mécène : Mme de Sévigné, Mme de
La Fayette, les d’Herwart, le Grand Corneille flanqué de son
frère Thomas y coudoient Sapho, c’est-à-dire Madeleine de
Scudéry ; Ménage, qui est savant et précieux ; Charles Sorel,
qui est burlesque et antiprécieux ; Boisrobert, abbé galant, ancien
factotum littéraire de Richelieu et fondateur de l’Académie ;
Scarron, burlesque, romanesque, tragique et comique, avec cela
cul-de-jatte ; le docte P. Lemoyne ; le vieux Costar, ami de feu
l’illustre M. de Balzac ; le romancier Gombaud ; les poètes
Brébeuf, Boyer, Félibien ; Quinault, qui fait des tragédies en
attendant de faire des opéras avec Lulli ; Charles Perrault, futur
champion des Modernes contre les Anciens, qui restera, pour
la postérité populaire, l’auteur des Contes de Fées ; Benserade,
ancien « palatin de la Table Ronde » qui « madrigalise » sur tous
les tons ; et Pellisson, autre « palatin » de la Table Ronde, qui est
laid, protestant, pieux, adorateur de Sapho et qui est important
parce qu’il a la confiance du maître.
A vrai dire, la mode littéraire, chez Fouquet, portait aux grâces
rétrogrades. La Fontaine y sacrifiait sans se faire prier, sinon de
bon cœur, écrivant rondeaux sur madrigaux, ballades sur épîtres,
épigrammes et odes sur dizains et sizains, un ballet-féerie : les
Rieurs du Beau-Richard, le Songe de Vaux qui restera inachevé
parce que tout ce monde fut bientôt réveillé en sursaut, mille
choses légères qui s’envolaient aux vents de la vie mondaine. Mais
il acquiert ainsi cette souplesse de forme et d’esprit qui fera mer
veille- dans les Fables : Diversité, c’est ma devise.
Cependant, au moment où il brille au premier rang, il se pré
pare secrètement à fausser compagnie à ces précieux, ces géné
reux, ces romanesques, ces burlesques. Son goût, très sûr, nourri
de la lecture des Anciens et de Descartes, le portait vers un art
de vérité, de raison, de mesure. Il en eut la révélation parfaite le
17 août 1661. Ce jour-là, Fouquet recevait à Vaux le roi Louis XIV