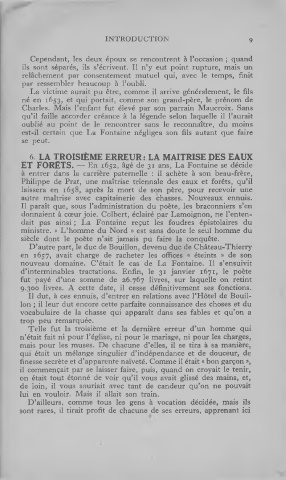Page 13 - Les fables de Lafontaine
P. 13
INTRODUCTION 9
Cependant, les deux époux se rencontrent à l’occasion ; quand
ils sont séparés, ils s’écrivent. Il n’y eut point rupture, mais un
relâchement par consentement mutuel qui, avec le temps, finit
par ressembler beaucoup à I’oubii.
La victime aurait pu être, comme il arrive généralement, le fils
né en 1653, et qui portait, comme son grand-père, le prénom de
Charles. Mais l’enfant fut élevé par son parrain Maucroix. Sans
qu’il faille accorder créance à la légende selon laquelle il l’aurait
oublié au point de le rencontrer sans le reconnaître, du moins
est-il certain que La Fontaine négligea son fils autant que faire
se peut.
6. LA TROISIÈME ERREUR: LA MAITRISE DES EAUX
ET FORÊTS. — En 1652, âgé de 31 ans, La Fontaine se décide
à entrer dans la carrière paternelle : il achète à son beau-frère,
Philippe de Prat, une maîtrise triennale des eaux et forêts, qu’il
laissera en 1658, après la mort de son père, pour recevoir une
autre maîtrise avec capitainerie des chasses. Nouveaux ennuis.
Il paraît que, sous l’administration du poète, les braconniers s’en
donnaient à cœur joie. Colbert, éclairé par Lamoignon, ne l’enten
dait pas ainsi ; La Fontaine reçut les foudres épistolaires du
ministre. « L’homme du Nord » est sans doute le seul homme du
siècle dont le poète n’ait jamais pu faire la conquête.
D’autre part, le duc de Bouillon, devenu duc de Château-Thierry
en 1657, avait charge de racheter les offices « éteints » de son
nouveau domaine. C’était le cas de La Fontaine. Il s’ensuivit
d’interminables tractations. Enfin, le 31 janvier 1671, le poète
fut payé d’une somme de 26.767 livres, sur laquelle on retint
9.300 livres. A cette date, il cesse définitivement ses fonctions.
Il dut, à ces ennuis, d’entrer en relations avec l’Hôtel de Bouil
lon ; il leur dut encore cette parfaite connaissance des choses et du
vocabulaire de la chasse qui apparaît dans ses fables et qu’on a
trop peu remarquée.
Telle fut la troisième et la dernièrè erreur d’un homme qui
n’était fait ni pour l’église, ni pour le mariage, ni pour les charges,
mais pour les muses. De chacune d’elles, il se tira à sa manière,
qui était un mélange singulier d’indépendance et de douceur, de
finesse secrète et d’apparente naïveté. Comme il était « bon garçon »,
il commençait par se laisser faire, puis, quand on croyait le tenir,
on était tout étonné de voir qu’il vous avait glissé des mains, et,
de loin, il vous souriait avec tant de candeur qu’on ne pouvait
lui en vouloir. Mais il allait son train.
D’ailleurs, comme tous les gens à vocation décidée, mais ils
sont rares, il tirait profit de chacune de ses erreurs, apprenant ici