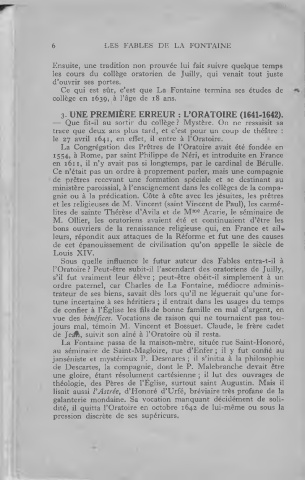Page 10 - Les fables de Lafontaine
P. 10
6 LES FABLES DE LA FONTAINE
Ensuite, une tradition non prouvée lui fait suivre quelque temps
les cours du collège oratorien de Juilly, qui venait tout juste
d’ouvrir ses portes.
Ce qui est sûr, c’est que La Fontaine termina ses études de
collège en 1639, à l’âge de 18 ans.
3. UNE PREMIÈRE ERREUR : L’ORATOIRE (1641-1642).
-— Que fit-il au sortir du collège ? Mystère. On ne ressaisit sa
trace que deux ans plus tard, et c’est pour un coup de théâtre :
le 27 avril 1641, en effet, il entre à l’Oratoire.
La Congrégation des Prêtres de l’Oratoire avait été fondée en
1554, à Rome, par saint Philippe de Néri, et introduite en France
en 1611, il n’y avait pas si longtemps, par le cardinal de Bérulle.
Ce n’était pas un ordre à proprement parler, mais une compagnie
de prêtres recevant une formation spéciale et se destinant au
ministère paroissial, à l’enseignement dans les collèges de la compa
gnie ou à la prédication. Côte à côte avec les jésuites, les prêtres
et les religieuses de M. Vincent (saint Vincent de Paul), les carmé
lites de sainte Thérèse d’Avila et de Mme Acarie, le séminaire de
M. Ollier, les oratoriens avaient été et continuaient d’être les
bons ouvriers de la renaissance religieuse qui, en France et ail
leurs, répondit aux attaques de la Réforme et fut une des causes
de cet épanouissement de civilisation qu’on appelle le siècle de
Louis XIV.
Sous quelle influence le futur auteur des Fables entra-t-il à
l’Oratoire? Peut-être subit-il l’ascendant des oratoriens de Juilly,
s’il fut vraiment leur élève ; peut-être obéit-il simplement à un
ordre paternel, car Charles de La Fontaine, médiocre adminis
trateur de ses biens, savait dès lors qu’il ne léguerait qu’une for
tune incertaine à ses héritiers ; il entrait dans les usages du temps
de confier à l’Église les fils de bonne famille en mal d’argent, en
vue des bénéfices. Vocations de raison qui ne tournaient pas tou
jours mal, témoin M. Vincent et Bossuet. Claude, le frère cadet
de JedR, suivit son aîné à l’Oratoire où il resta.
La Fontaine passa de la maisoh-mère, située rue Saint-Honoré,
au séminaire de Saint-Magloire, rue d’Enfer ; il y fut confié au
janséniste et mystérieux P. Desmares ; il s’initia à la philosophie
de Descartes, la compagnie, dont le P. Malebranche devait être
une gloire, étant résolument cartésienne ; il lut des ouvrages de
théologie, des Pères de l’Église, surtout saint Augustin. Mais il
lisait aussi l’Astrée, d’Honoré d’Urfé, bréviaire très profane de la
galanterie mondaine. Sa vocation manquant décidément de soli
dité, il quitta l’Oratoire en octobre 1642 de lui-même ou sous la
pression discrète de ses supérieurs.