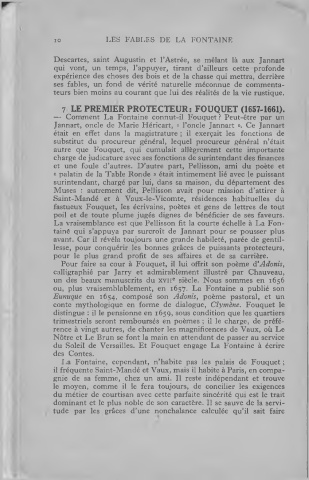Page 14 - Les fables de Lafontaine
P. 14
IO LES FABLES DE LA FONTAINE
Descartes, saint Augustin et l’Astrée, se mêlant là aux Jannart
qui vont, un temps, l’appuyer, tirant d’ailleurs cette profonde
expérience des choses des bois et de la chasse qui mettra, derrière
ses fables, un fond de vérité naturelle méconnue de commenta
teurs bien moins au courant que lui des réalités de la vie rustique.
7 LE PREMIER PROTECTEUR: FOUQUET (1657-1661).
— Comment La Fontaine connut-il Fouquet ? Peut-être par un
Jannart, oncle de Marie Héricart, « l’oncle Jannart ». Ce Jannart
était en effet dans la magistrature ; il exerçait les fonctions de
substitut du procureur général, lequel procureur général n’était
autre que Fouquet, qui cumulait allègrement cette importante
charge de judicature avec ses fonctions de surintendant des finances
et une foule d’autres. D’autre part, Pellisson, ami du poète et
« palatin de la Table Ronde » était intimement lié avec le puissant
surintendant, chargé par lui, dans sa maison, du département des
Muses : autrement dit, Pellisson avait pour mission d’attirer à
Saint-Mandé et à Vaux-le-Vicomte, résidences habituelles du
fastueux Fouquet, les écrivains, poètes et gens de lettres de tout
poil et de toute plume jugés dignes de bénéficier de ses faveurs.
La vraisemblance est que Pellisson fit la courte échelle à La Fon-
tainê qui s’appuya par surcroît de Jannart pour se pousser plus
avant. Car il révéla toujours une grande habileté, parée de gentil
lesse, pour conquérir les bonnes grâces de puissants protecteurs,
pour le plus grand profit de ses affaires et de sa carrière.
Pour faire sa cour à Fouquet, il lui offrit son poème A’Adonis,
calligraphié par Jarry et admirablement illustré par Chauveau,
un des beaux manuscrits du xvne siècle. Nous sommes en 1656
ou, plus vraisemblablement, en 1657. La Fontaine a publié son
Eunuque en 1654, composé son Adonis, poème pastoral, et un
conte mythologique en forme de dialogue, Clymène. Fouquet le
distingue : il le pensionne en 1659, sous condition que les quartiers
trimestriels seront remboursés en poèmes ; il le charge, de préfé
rence à vingt autres, de chanter les magnificences de Vaux, où Le
Nôtre et Le Brun se font la main en attendant de passer au service
du Soleil de Versailles. Et Fouquet engage La Fontaine à écrire
des Contes.
La Fontaine, cependant, n’habite pas les palais de Fouquet ;
il fréquente Saint-Mandé et Vaux, mais il habite à Paris, en compa
gnie de sa femme, chez un ami. Il reste indépendant et trouve
le moyen, comme il le fera toujours, de concilier les exigences
du métier de courtisan avec cette parfaite sincérité qui est le trait
dominant et le plus noble de son caractère. Il se sauve de la servi
tude par les grâces d’une nonchalance calculée qu’il sait faire