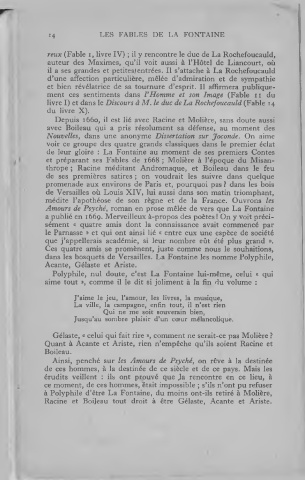Page 18 - Les fables de Lafontaine
P. 18
14 LES FABLES DE LA FONTAINE
reux (Fable 1, livre IV) ; il y rencontre le duc de La Rochefoucauld,
auteur des Maximes, qu’il voit aussi à l’Hôtel de Liancourt, où
il a ses grandes et petitesjentrées. Il s’attache à La Rochefoucauld
d’une affection particulière, mêlée d’admiration et de sympathie
et bien révélatrice de sa tournure d’esprit. Il affirmera publique
ment ces sentiments dans l’Homme et son Image (Fable 11 du
livre I) et dans le Discours à M. le duc de La Rochefoucauld (Fable 14
du livre X).
Depuis 1660, il est lié avec Racine et Molière, sans doute aussi
avec Boileau qui a pris résolument sa défense, au moment des
Nouvelles, dans une anonyme Dissertation sur Joconde. On aime
voir ce groupe des quatre grands classiques dans le premier éclat
de leur gloire : La Fontaine au moment de ses premiers Contes
et préparant ses Fables de 1668 ; Molière à l’époque du Misan
thrope ; Racine méditant Andromaque, et Boileau dans le feu
de ses premières satires ; on voudrait les suivre dans quelque
promenade aux environs de Paris et, pourquoi pas ? dans les bois
de Versailles où Louis XIV, lui aussi dans son matin triomphant,
médite l’apothéose de son règne et de la France. Ouvrons les
Amours de Psyché, roman en prose mêlée de vers que La Fontaine
a publié en 1669. Merveilleux à-propos des poètes ! On y voit préci
sément « quatre amis dont la connaissance avait commencé par
le Parnasse » et qui ont ainsi lié « entre eux une espèce de société
que j’appellerais académie, si leur nombre eût été plus grand ».
Ces quatre amis se promènent, juste comme nous le souhaitions,
dans les bosquets de Versailles. La Fontaine les nomme Polyphile,
Acante, Gélaste et Ariste.
Polyphile, nul doute, c’est La Fontaine lui-même, celui « qui
aime tout », comme il le dit si joliment à la fin du volume :
J’aime le jeu, l’amour, les livres, la musique,
La ville, la campagne, enfin tout, il n’est rien
Qui ne me soit souverain bien,
Jusqu’au sombre plaisir d’un cœur mélancolique.
Gélaste, « celui qui fait rire », comment ne serait-ce pas Molière ?
Quant à Acante et Ariste, rien n’empêche qu’ils soient Racine et
Boileau.
Ainsi, penché sur les Amours de Psyché, on rêve à la destinée
de ces hommes, à la destinée de ce siècle et de ce pays. Mais les
érudits veillent : ils ont prouvé que Ja rencontre en ce lieu, à
ce moment, de ces hommes, était impossible ; s’ils n’ont pu refuser
à Polyphile d’être La Fontaine, du moins ont-ils retiré à Molière,
Racine et Boileau tout droit à être Gélaste, Acante et Ariste.