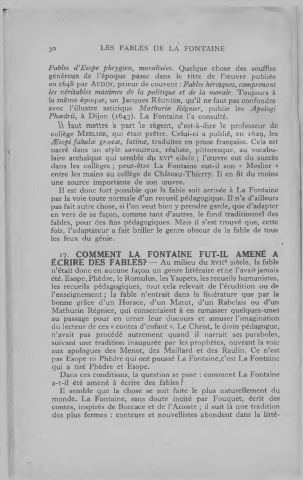Page 34 - Les fables de Lafontaine
P. 34
3° LES FABLES DE LA FONTAINE
Fables d'Esope phrygien, moralistes. Quelque chose des souffles
généreux de l’époque passe dans le titre de l’œuvre publiée
en 1648 par Audin, prieur de couvent : Fables héroïques, comprenant
les véritables maximes de la politique et de la morale. Toujours à
la même époque, un Jacques Régnier, qu’il ne faut pas confondre
avec l’illustre satirique Mathurin Régnier, publie les Apologi
Phædrii, à Dijon (1643). La Fontaine l’a consulté.
Yï îaut mettre a part Je régent, c'est-à-dire le professeur de
collège Meslier, qui était prêtre. Celui-ci a publié, en 1629, les
Æsopi fabulez grœcee, latince, traduites en prose française. Cela est
narré dans un style savoureux, réaliste, pittoresque, au vocabu
laire archaïque qui semble dp xvie siècle ; l’œuvre eut du succès
dans les collèges ; peut-être La Fontaine eut-il son « Meslier »
entre les mains au collège de Château-Thierry. Il en fit du moins
une source importante de son œuvre.
Il est donc fort possible que la fable soit arrivée à La Fontaine
par la voie toute normale d’un recueil pédagogique. Il n’a d’ailleurs
pas fait autre chose, si l’on veut bien y prendre garde, que d’adapter
en vers de sa façon, comme tant d’autres, le fond traditionnel des
fables, pour des fins pédagogiques. Mais il s’est trouvé que, cette
fois, l’adaptateur a fait briller le genre obscur de la fable de tous
les feux du génie.
17. COMMENT LA FONTAINE FUT-IL AMENÉ A
ÉCRIRE DES FABLES? — Au milieu du xvne siècle, la fable
n’était donc en aucune façon un genre littéraire et ne l’avait jamais
été. Esope, Phèdre, le Romulus, les Ysopets, les recueils humanistes,
les recueils pédagogiques, tout cela relevait de l’érudition ou de
l’enseignement ; la fable n’entrait dans la littérature que par la
bonne grâce d’un Horace, d’un Marot, d’un Rabelais ou d’un
Mathurin Régnier, qui consentaient à en ramasser quelques-unes
au passage pour en orner leur discours et amuser l’imagination
du lecteur de ces « contes d’enfant ». Le Christ, le divin pédagogue,
n’avait pas procédé autrement quand il narrait ses paraboles,
suivant une tradition inaugurée par les prophètes, ouvrant la voie
aux apologues des Menot, des Maillard et des Raulin. Ce n’est
pas Esope ni Phèdre qui ont poussé La Fontaine,c’est La Fontaine
qui a tiré Phèdre et Esope.
Dans ces conditions, la question se pose : comment La Fontaine
a-t-il été amené à écrire des fables ?
Il semble que la chose se soit faite le plus naturellement du
monde. La Fontaine, sans doute incité par Fouquet, écrit des
contes, inspirés de Boccace et de l’Arioste ; il suit là une tradition
des plus fermes : conteurs et nouvellistes abondent dans la litté-