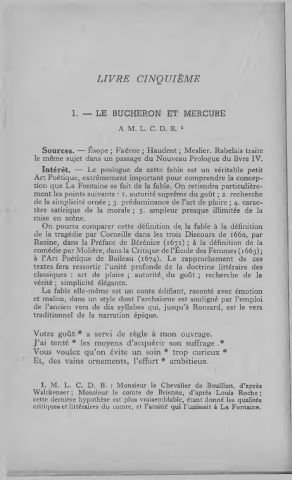Page 212 - Les fables de Lafontaine
P. 212
LIVRE CINQUIÈME
1. — LE BUCHERON ET MERCURE
A M. L. C. D. B. »
Sources. — Ésope ; Faërne ; Haudent ; Meslier. Rabelais traite
le même sujet dans un passage du Nouveau Prologue du livre IV.
Intérêt. — Le prologue de cette fable est un véritable petit
Art Poétique, extrêmement important pour comprendre la concep
tion que La Fontaine se fait de la fable. On retiendra particulière
ment les points suivants : i. autorité suprême du goût ; 2. recherche
de la simplicité ornée ; 3. prédominance de l’art de plaire ; 4. carac
tère satirique de la morale ; 5. ampleur presque illimitée de la
mise en scène.
On pourra comparer cette définition de, la fable à la définition
de la tragédie par Corneille dans les trois Discours de 1660, par
Racine, dans la Préface de Bérénice (1671) ; à la définition de la
comédie par Molière, dans la Critique de l’École des Femmes (1663) ;
à l’Art Poétique de Boileau (1674). Le rapprochement de ces
textes fera ressortir l’unité profonde de la doctrine littéraire des
classiques : art de plaire ; autorité du goût ; recherche de la
vérité ; simplicité élégante.
La fable elle-même est un conte édifiant, raconté avec émotion
et malice, dans un style dont l’archaïsme est souligné par l’emploi
de l’ancien vers de dix syllabes qui, jusqu’à Ronsard, est le vers
traditionnel de la narration épique.
Votre goût * a servi de règle à mon ouvrage.
J’ai tenté * les moyens d’acquérir son suffrage .*
Vous voulez qu’on évite un soin * trop curieux *
Et, des vains ornements, l’effort * ambitieux.
1. M. L. C. D. B. : Monsieur le Chevalier de Bouillon, d’après
Walckenaer ; Monsieur le comte de Brienne, d’après Louis Roche ;
cette dernière hypothèse est plus vraisemblable, étant donné les qualités
critiques et littéraires du comte, et l’amitié qui l’unissait à La Fontaine.