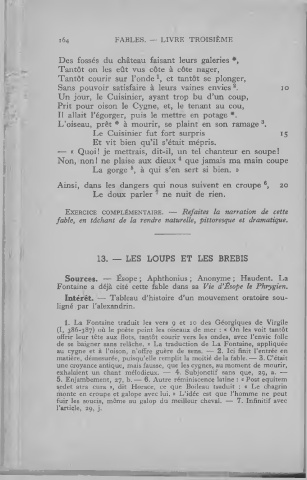Page 168 - Les fables de Lafontaine
P. 168
164 FABLES. — LIVRE TROISIÈME
Des fossés du château faisant leurs galeries *,
Tantôt on les eût vus côte à côte nager,
Tantôt courir sur l’onde4, et tantôt se plonger,
Sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies 1. 10
2
Un jour, le Cuisinier, ayant trop bu d’un coup,
Prit pour oison le Cygne, et, le tenant au cou,
Il allait l’égorger, puis le mettre en potage *.
L’oiseau, prêt * à mourir, se plaint en son ramage 3 *
.
5
Le Cuisinier fut fort surpris 15
Et vit bien qu’il s’était mépris.
— « Quoi! je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe!
Non, non! ne plaise aux dieux 4 que jamais ma main coupe
La gorge 6, à qui s’en sert si bien. »
Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe 6, 20
Le doux parler 7 ne nuit de rien.
Exercice complémentaire. — Refaites la narration de cette
fable, en tâchant de la rendre naturelle, pittoresque et dramatique.
13. — LES LOUPS ET LES BREBIS
Sources. — Ésope ; Aphthonius ; Anonyme ; Haudent. La
Fontaine a déjà cité cette fable dans sa Vie d’Ésope le Phrygien.
Intérêt. — Tableau d’histoire d’un mouvement oratoire sou
ligné par l’alexandrin.
1. La Fontaine traduit les vers 9 et 10 des Géorgiques de Virgile
(I, 386-387) où le poète peint les oiseaux de mer : « On les voit tantôt
offrir leur tête aux flots, tantôt courir vers les ondes, avec l’envie folle
de se baigner sans relâche. » La traduction de La Fontaine, appliquée
au cygne et à l’oison, n’offre guère de sens. -— 2. Ici finit l’entrée en
matière, démesurée, puisqu’elle remplit la moitié delà fable.— 3. C’était
une croyance antique, mais fausse, que les cygnes, au moment de mourir,
exhalaient un chant mélodieux. — 4. Subjonctif sans que, 29, a. —
5. Enjambement, 27, b. — 6. Autre réminiscence latine : « Post equitem
sedet atra cura », dit Horace, ce que Boileau traduit : « Le chagrin
monte en croupe et galope avec lui. » L’idée est que l’homme ne peut
fuir les soucis, même au galop du meilleur cheval. — 7. Infinitif avec
l’article, 29, j.