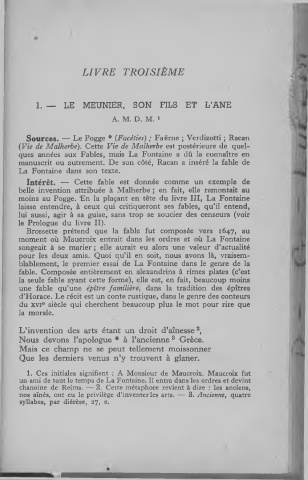Page 151 - Les fables de Lafontaine
P. 151
LIVRE TROISIÈME
1. — LE MEUNIER, SON FILS ET L’ANE
A. M. D. M. 1
Sources. — Le Pogge * (Facéties) ; Faërne ; Verdizotti ; Racan
(Vie de Malherbe). Cette Vie de Malherbe est postérieure de quel
ques années aux Fables, mais La Fontaine a dû la connaître en
manuscrit ou autrement. De son côté, Racan a inséré la fable de
La Fontaine dans son texte.
Intérêt. — Cette fable est donnée comme un exemple de
belle invention attribuée à Malherbe ; en fait, elle remontait au
moins au Pogge. “En la plaçant en tête du livre III, La Fontaine
laisse entendre, à ceux qui critiqueront ses fables, qu’il entend,
lui aussi, agir à sa guise, sans trop se soucier des censeurs (voir
le Prologue du livre II).
Brossette prétend que la fable fut composée vers 1647, au
moment où Maucroix entrait dans les ordres et où La Fontaine
songeait à se marier ; elle aurait eu alors une valeur d’actualité
pour les deux amis. Quoi qu’il en soit, nous avons là, vraisem
blablement, le premier essai de La Fontaine dans le genre de la
fable. Composée entièrement en alexandrins à rimes plates (c’est
la seule fable ayant cette forme), elle est, en fait, beaucoup moins
une fable qu’une épître familière, dans la tradition des épîtres
d’Horace. Le récit est un conte rustique, dans le genre des conteurs
du XVIe siècle qui cherchent beaucoup plus le mot pour rire que
la morale.
L’invention des arts étant un droit d’aînesse2,
Nous devons l’apologue * à l’ancienne 3 Grèce.
Mais ce champ ne se peut tellement moissonner
Que les derniers venus n’y trouvent à glaner.
1. Ces initiales signifient : A Monsieur de Maucroix. Maucroix fut
un ami de toüt le temps de La Fontaine. Il entra dans les ordres et devint
chanoine de Reims. — 2. Cette métaphore revient à dire : les anciens,
nos aînés, ont eu le privilège d’inventer les arts. — 3. Ancienne, quatre
syllabes, par diérèse, 27, e.