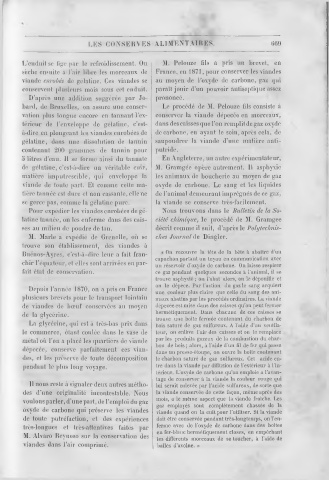Page 675 - Merveilles Industrie Tome 4
P. 675
LES CONSERVES ALIMENTAIRES. 669
L’enduit se fige par le refroidissement. On M. Pelouze fils a pris un brevet, en
sèche ensuite à l'air libre les morceaux de France, en 1871, pour conserver les viandes
viande enrobés de gélatine. Ces viandes se au moyen de l'oxyde de carbone, gaz qui
conservent plusieurs mois sous cet enduit. paraît jouir d’un pouvoir antiseptique assez
D’après une addition suggérée par Jo prononcé.
bard, de Bruxelles, on assure une conser Le procédé de M. Pelouze fils consiste à
vation plus longue encore en tannant l’ex conserver la viande dépecée en morceaux,
térieur de l’enveloppe de gélatine, c’est- dans des caisses que l’on remplit de gaz oxyde
à-dire en plongeant les viandes enrobées de de carbone, en ayant le soin, après cela, de
gélatine, dans une dissolution de tannin saupoudrer la viande d’une matière anti
contenant 200 grammes de tannin pour putride.
5 litres d’eau. Il se forme ainsi du tannate En Angleterre, un autre expérimentateur,
de gélatine, c’est-à-dire un véritable cuir, M. Gramgée opère autrement. Il asphyxie
matière imputrescible, qui enveloppe la les animaux de boucherie au moyen de gaz
viande de toute part. Et comme cette ma oxyde de carbone. Le sang et les liquides
tière tannée est dure et non cassante, elle ne de l’animal demeurant imprégnés de ce gaz,
se gerce pas, comme la gélatine pure. la viande se conserve très-facilement.
Pour expédier les viandes enrobées de gé Nous trouvons dans le Bulletin de la So
latine tannée, on les enferme dans des cais ciété chimique, le procédé de M. Gramgee
ses au milieu de poudre de tan. décrit comme il suit, d’après le Polytechnis-
M. Marie a expédié de Grenelle, où se clies Journal de Dingler.
trouve son établissement, des viandes à
Buénos-Ayres, c’est-à-dire leur a fait fran « On recouvre la tète de la bête à abattre d'un
capuchon portant un tuyau en communication avec
chir l’équateur, et elles sont arrivées en par un réservoir d’oxyde de carbone. On laisse respirer
fait état de conservation. ce gaz pendant quelques secondes à l’animal, il se
trouve asphyxié ; on l’abat alors, on le dépouille et
on le dépèce. Par l’action du gaz le sang acquiert
Depuis l’année 1870, on a pris en France
une couleur plus claire que celle du sang des ani
plusieurs brevets pour le transport lointain maux abattus par les procédés ordinaires. La viande
de viandes de bœuf conservées au moyen dépecée est mise dans des caisses qu’on peut fermer
de la glycérine. hermétiquement. Dans chacune de ces caisses se
trouve une boite fermée contenant du charbon de
La glycérine, qui est à très-bas prix dans bois saturé de gaz sulfureux. A l’aide d’un ventila
le commerce, étant coulée dans le vase de teur, ôn enlève l’air des caisses et on le remplace
métal où l’on a placé les quartiers de viande parles produits gazeux de la combustion du char
bon de bois ; alors, à l’aide d’un fil de fer qui passe
dépecée, conserve parfaitement ces vian
dans un presse-étoupe, on ouvre la boîte contenant
des, et les préserve de toute décomposition le charbon saturé de gaz sulfureux. Cet acide en
pendant le plus long voyage. tre dans la viande par diffusion de l’extérieur à l’in
térieur. L’oxyde de carbone qu’on emploie a l’avan
tage de conserver à la viande la couleur rouge qui
Il nous reste à signaler deux autres métho lui serait enlevée par l’acide sulfureux, de sorte que
des d’une originalité incontestable. Nous la viande conservée de cette façon, même après des
voulons parler, d'une part, de l’emploi du gaz mois, a le même aspect que la viande fraîche. Les
gaz employés sont complètement chassés de la
oxyde de carbone qui préserve les viandes viande quand on la cuit pour l’utiliser. Si la viande
de toute putréfaction, et des expériences doit être conservée pendant très-longtemps, on l’en
très-longues et très-attentives faites par ferme avec de l’oxyde de carbone dans des boîtes
en fer-blanc hermétiquement closes, en empêchant
M. Alvaro Reynoso sur la conservation des
les différents morceaux de se toucher, à l’aide de
viandes dans l’air comprimé. balles d’avoine. »