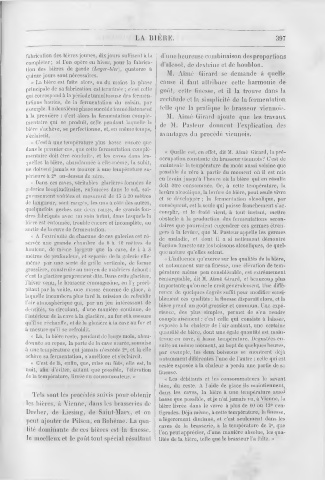Page 403 - Merveilles Industrie Tome 4
P. 403
LA BIÈRE. 397
fabrication des bières jeunes, dix jours suffisent à la d’une heureuse combinaison des proportions
compléter ; si l’on opère en hiver, pour la fabrica d’alcool, de dextrine et de houblon.
tion des bières de garde (Lager-bier), quatorze à
quinze jours sont nécessaires. M. Aimé Girard se demande à quelle
« La bière est faite alors, ou du moins la phase cause il faut attribuer cette harmonie de
principale de sa fabrication est terminée ; c’est celle goût, cette finesse, et il la trouve dans la
qui correspond à la période tumultueuse des fermen
tations hautes, de la fermentation du raisin, par rectitude et la simplicité de la fermentation
exemple. La deuxième phase succède immédiatement telle que la pratique le brasseur viennois.
à la première : c’est alors la fermentation complé M. Aimé Girard ajoute que les travaux
mentaire qui se produit, celle pendant laquelle la de M. Pasteur donnent l’explication des
bière s’achève, se perfectionne, et, en même temps,
s’éclaircit. avantages du procédé viennois.
« C’est à une température plus basse encore que
dans le premier cas, que cette fermentation complé « Quelle est, en effet, dit M. Aimé Girard, la pré
mentaire doit être conduite, et les caves dans les occupation constante du brasseur viennois? C’est de
quelles la bière, abandonnée à elle-même, la subit, maintenir la température du moût aussi voisine que
ne doivent jamais se trouver à une température su possible de zéro à partir du moment où il est mis
périeure à 2° au-dessus de zéro. en levain jusqu’à l’heure où la bière qui en résulte
« Dans ces caves, véritables glacières formées de doit être consommée. Or, à cette température, la
galeries longitudinales, enfoncées dans le sol, soi- i levûre alcoolique, la levûre de bière, peut seule vivre
gneusement voûtées et mesurant de 15 à 20 mètres et se développer ; la fermentation alcoolique, par
de longueur, sont rangés, les uns à côté des autres, conséquent, est la seule qui puisse franchement s’ac-
quelquefois gerbés sur deux rangs, de grands fou complir, et le froid vient, à tout instant, mettre
dres fabriqués avec un soin infini, dans lesquels la obstacle à la production des fermentations secon
bière est entonnée, trouble encore et incomplète, au daires que pourraient engendrer ces germes étran
sortir de la cuve de fermentation. gers à la levûre, que M. Pasteur appelle les germes
« A l’extrémité de chacune de ces galeries est ré de maladie, et dont il a si nettement démontré
servée une grande chambre de 8 à 10 mètres de l’action funeste sur les boissons alcooliques, de quel
hauteur, de même largeur que la cave, de 4 à 5 que nature qu’elles soient.
mètres de profondeur, et séparée de la galerie elle- « L’influence qu’exerce sur les qualités de la bière,
même par une sorte de grille verticale, de forme et notamment sur sa finesse, une élévation de tem
grossière, construite au moyen de madriers debout : pérature même peu considérable, est extrêmement
c’est la glacière proprement dite. Dans cette glacière, remarquable, dit M. Aimé Girard, et beaucoup plus
l’hiver venu, le brasseur emmagasine, en l'v préci importante qu’on ne le croit généralement. Une diffé
pitant par la voûte, une masse énorme de glace, à rence de quelques degrés suffit pour modifier sensi
laquelle incombera plus tard la mission de refroidir blement ces qualités : la finesse disparaît alors, et la
l’air atmosphérique qui, par un jeu intéressant de bière prend un goût grossier et commun. Une expé
densités, va circulant, d’une manière continue, de rience, des plus simples, permet de s’en rendre
l’intérieur de la cave à la glacière, au fur et à mesure compte aisément : c’est celle qui consiste à laisser,
qu’il se réchauffe, et de la glacière à la cave au fur et exposée à la chaleur de l’air ambiant, une certaine
à mesure qu’il se refroidit. quantité de bière, dont une égale quantité est main
« Là, la bière reste, pendant de longs mois, aban tenue en cave, à basse température. Dégustées en
donnée au repos, la porte de la cave murée, soumise suite au même moment, au bopt de quelques heures,
à une température qui jamais n’excède 2°, et là elle par exemple, les deux boissons se montrent déjà
achève sa fermentation, s’améliore et s’éclaircit. notamment différentes l’une de l’autre : celle qui est
« C’est de là, enfin, que, mise en fûts, elle est, la restée exposée à la chaleur a perdu une partie de sa
nuit, afin d’éviter, autant que possible, l’élévation finesse.
de la température, livrée au consommateur. »
« Les débitants et les consommateurs le savent
bien, du reste. A l’aide de glace ils maintiennent,
dans les caves, la bière à une température aussi
Tels sont les procédés suivis pour obtenir
basse que possible, et je n’ai jamais vu, à Vienne, la
les bières, à Vienne, dans les brasseries de bière livrée dans le verre à plus de 10 ou 12° cen
Dreher, de Liesing, de Saint-Marx, et on tigrades. Déjà même, à cette température, la finesse,
peut ajouter de Pilsen, en Bohême. La qua a légèrement diminué, et c’est seulement dans les
caves de la brasserie, à la température de 2°, que
lité dominante de ces bières est la finesse,
l’on peut apprécier, d’une manière absolue, les qua
le moelleux et le goût tout spécial résultant lités de la bière, telle que le brasseur l’a faite. »