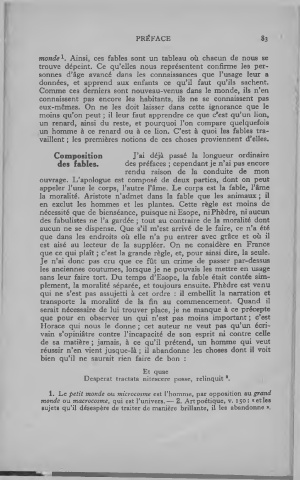Page 87 - Les fables de Lafontaine
P. 87
PRÉFACE 83
monde1. Ainsi, ces fables sont un tableau où chacun de nous se
trouve dépeint. Ce qu’elles nous représentent confirme les per
sonnes d’âge avancé dans les connaissances que l’usage leur a
données, et apprend aux enfants ce qu’il faut qu’ils sachent.
Comme ces derniers sont nouveau-venus dans le monde, ils n’en
connaissent pas encore les habitants, ils ne se connaissent pas
eux-mêmes. On ne les doit laisser dans cette ignorance que le
moins qu’on peut ; il leur faut apprendre ce que c’est qu’un lion,
un renard, ainsi du reste, et pourquoi l’on compare quelquefois
un homme à ce renard ou à ce lion. C’est à quoi les fables tra
vaillent ; les premières notions de ces choses proviennent d’elles.
Composition J’ai déjà passé la longueur ordinaire
des fables. des préfaces ; cependant je n’ai pas encore
rendu raison de la conduite de mon
ouvrage. L’apologue est composé de deux parties, dont on peut
appeler l’une le corps, l’autre l’âme. Le corps est la fable, l’âme
la moralité. Aristote n’admet dans la fable que les animaux ; il
en exclut les hommes et les plantes. Cette règle est moins de
nécessité que de bienséance, puisque ni Esope, ni Phèdre, ni aucun
des fabulistes ne l’a gardée ; tout au contraire de la moralité dont
aucun ne se dispense. Que s’il m’est arrivé de le faire, ce n’a été
que dans les endroits où elle n’a pu entrer avec grâce et où il
est aisé au lecteur de la suppléer. On ne considère en France
que ce qui plaît ; c’est la grande règle, et, pour ainsi dire, la seule.
Je n’ai donc pas cru que ce fût un crime de passer par-dessus
les anciennes coutumes, lorsque je ne pouvais les mettre en usage
sans leur faire tort. Du temps d’Esope, la fable était contée sim
plement, la moralité séparée, et toujours ensuite. Phèdre est venu
qui ne s’est pas assujetti à cet ordre : il embellit la narration et
transporte la moralité de la fin au commencement. Quand il
serait nécessaire de lui trouver place, je ne manque à ce précepte
que pour en observer un qui n’est pas moins important ; c’est
Horace qui nous le donne ; cet auteur ne veut pas qu’un écri
vain s’opiniâtre contre l’incapacité de son esprit ni contre celle
de sa matière ; jamais, à ce qu’il prétend, un homme qui veut
réussir n’en vient jusque-là ; il abandonne les choses dont il voit
bien qu’il ne saurait rien faire de bon :
Et quae
Desperat tractata nitescere posse, relinquit a.
1. Le petit monde ou microcosme est l’homme, par opposition au grand
monde ou macrocosme, qui est l’univers. — 2. Art poétique, v. 150 : « et les
sujets qu’il désespère de traiter de manière brillante, il les abandonne ».