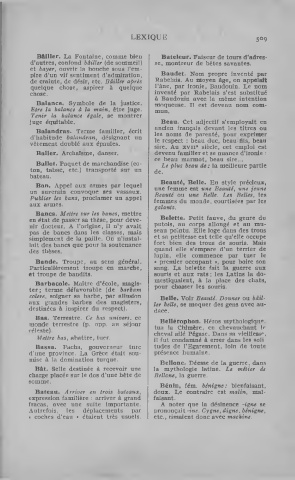Page 511 - Les fables de Lafontaine
P. 511
LEXIQUE 5°9
Bâiller. I^a Fontaine, comme bien Bateleur. Faiseur de tours d’adres
d’autres, confond bâiller (de sommeil) se, montreur de bêtes savantes.
et bayer, ouvrir la bouche sous l’em
pire d’un vif sentiment d’admiration, Baudet. Nom propre inventé par
de crainte, de désir, etc. Bâiller après Rabelais. Au moyen âge, on appelait
quelque chose, aspirer à quelque l’âne, par ironie, Baudouin. Le nom
chose. inventé par Rabelais s’est substitué
à Baudouin avec la même intention
Balance. Symbole de la justice. moqueuse. Il est devenu nom com
Etre la balance à la main, être juge. mun.
Tenir la balance égale, se montrer
juge équitable. Beau. Cet adjectif s’employait en
Balandras. Terme familier, écrit ancien français devant les titres ou
d’habitude ôaZandran, désignant un les noms de parenté, pour exprimer
le respect : beau duc, beau-fils, beau
vêtement doublé aux épaules. sire. Au xvn® siècle, cet emploi est
Baller. Archaïsme, danser. devenu familier et se nuance d’ironie :
ce beau marmot, beau sire...
Ballot. Paquet de marchandise (co Le plus beau de : la meilleure partie
ton, tabac, etc.) transporté sur un de.
bateau.
Beauté, Belle. Bn style précieux,
Ban. Appel aux armes par lequel
un suzerain convoque ses vassaux. une femme est une Beauté, une jeune
Beauté ou une Belle. Les Belles, les
Publier les bans, proclamer un appel
aux armes. femmes du monde, courtisées par les
galants.
Bancs. Mettre sur les bancs, mettre
en état de passer sa thèse, pour deve Belette. Petit fauve, du genre du
nir docteur. A l’origine, il n’y avait putois, au corps allongé et au mu
pas de bancs dans les classes, mais seau pointu. Bile loge dans des trous
simplement de la paille. On n’instal et sa petitesse est telle qu’elle occupe
lait des bancs que pour la soutenance fort bien des trous de souris. Mais
dès thèses. quand elle s’empare d’un terrier de
lapin, elle commence par tuer le
Bande. Troupe, au sens général. « premier occupant », pour boire son
Particulièrement troupe en marche, sang. La belette fait la guerre aux
et troupe de bandits. souris et aux rats ; les Latins la do
Barbacole. Maître d’école, magis- mestiquaient, à la place des chats,
pour chasser les souris.
ter ; terme défavorable (de barbant
colere, soigner sa barbe, par allusion Belle. Voir Beauté. Donner ou bâil
aux grandes barbes des magisters, ler belle, se moquer des gens avec au
destinées à inspirer du respect). dace.
Bas. Terrestre. Ce bas univers, ce
Bellérophon. Héros mythologique,
monde terrestre (p. opp. au séjour tua la Chimère, en chevauchant le
céleste). cheval ailé Pégase. Dans sa vieillesse,
Mettre bas, abattre, tuer. il fut condamné à errer dans les soli
Bassa. Pacha, gouverneur turc tudes de l’Egarement, loin de toute
d’une province. La Grèce était sou présence humaine.
mise à la domination turque.
Bellone. Déesse de la guerre, dans
Bât. Selle destinée à recevoir une la mythologie latine. Le métier de
charge placée sur le dos d’une bête de Bellone, la guerre.
somme.
Bénin, fém. bénigne : bienfaisant,
Bateau. Arriver en trois bateaux, doux. Le contraire est malin, mal
expression familière : arriver à grand faisant.
fracas, avec une suite importante. A noter que la désinence -igné se
Autrefois, les déplacements par prononçait -ine. Cygne, digne, bénigne,
« coches d’eau » étaient très usuels. etc., rimaient donc avec machine.