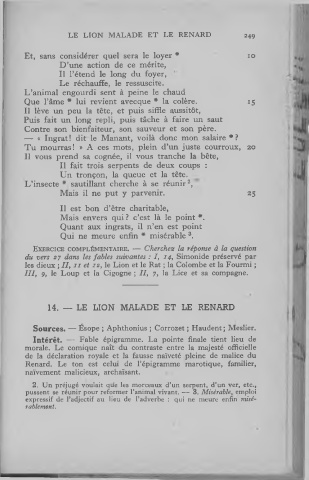Page 253 - Les fables de Lafontaine
P. 253
LE LION MALADE ET LE RENARD 249
Et, sans considérer quel sera le loyer * 10
D’une action de ce mérite,
Il l’étend le long du foyer,
Le réchauffe, le ressuscite.
L’animal engourdi sent à peine le chaud
Que l’âme * lui revient avecque * la colère. 15
Il lève un peu la tête, et puis siffle aussitôt,
Puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut
Contre son bienfaiteur, son sauveur et son père.
— « Ingrat ! dit le Manant, voilà donc mon salaire * ?
Tu mourras! » A ces mots, plein d’un juste courroux, 20
Il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête,
Il fait trois serpents de deux coups :
Un tronçon, la queue et la tête.
L’insecte * sautillant cherche à se réunir2,
Mais il ne put y parvenir. 25
Il est bon d’être charitable,
Mais envers qui ? c’est là le point *.
Quant aux ingrats, il n’en est point
Qui ne meure enfin * misérable 3.
Exercice complémentaire. — Cherchez la réponse à la question
du vers 27 dans les fables suivantes : I, 14, Simonide préservé par
les dieux ; II, 11 et 12, le Lion et le Rat ; la Colombe et la Fourmi ;
III, 9, le Loup et la Cigogne ; II, 7, la Lice et sa compagne.
14. — LE LION MALADE ET LE RENARD
Sources. — Ésope ; Aphthonius ; Corrozet ; Haudent ; Meslier.
Intérêt. — Fable épigramme. La pointe finale tient lieu de
morale. Le comique naît du contraste entre la majesté officielle
de la déclaration royale et la fausse naïveté pleine de malice du
Renard. Le ton est celui de l’épigramme marotique, familier,
naïvement malicieux, archaïsant.
2. Un préjugé voulait qùe les morceaux d’un serpent, d’un ver, etc.,
pussent se réunir pour reformer l’animal vivant. — 3. Misérable, emploi
expressif de l’adjectif au lieu de l’adverbe : qui ne meure enfin misé-
rahlement.