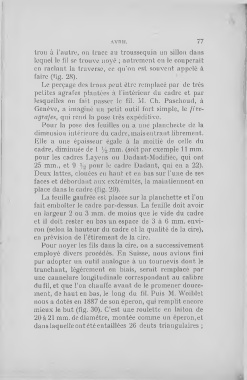Page 93 - la_conduite_du_rucher
P. 93
AVBII. 77
trou à l’autre, on trace au troussequin un sillon dans
lequel le fil se trouve noyé ; autrement on le couperait
en raclant la traverse, ce qu'on est souvent appelé à
faire (fig. 28).
Le perçage des trous peut être remplacé par de très
petites agrafes plantées à l’intérieur du cadre et par
lesquelles on fait passer le fil. M. Ch. Paschoud, à
Genève, a imaginé un petit outil fort simple, le /ire-
agrajes, qui rend la pose très expéditive.
Pour la pose des feuilles on a une planchette de la
dimension intérieure du cadre, mais entrant librement.
Elle a une épaisseur égale à la moitié de celle du
cadre, diminuée de 1 % mm. (soit par exemple 11 mm.
pour les cadres Layens ou DadantrModifiée, qui ont
25 min., et 9 pour le cadre Dadant, qui en a 22).
Deux lattes, clouées en haut et en bas sur l’une de ses
faces et débordant aux extrémités, la maintiennent en
place dans le cadre (fig. 29).
La feuille gaufrée est placée sur la planchette et l’on
fait emboîter le cadre par-dessus. La feuille doit avoir
en largeur 2 ou 3 mm. de moins que le vide du cadre
et il doit rester en bas un.espace de 3 à 6 mm. envi
ron (selon la hauteur du cadre et la qualité de la cire),
en prévision de l’étirement de la cire.
Pour noyer les fils dans la cire, on a successivement
employé divers procédés. En Suisse, nous avions fini
par adopter un outil analogue à un tournevis dont le
tranchant, légèrement en biais, serait remplacé par
une cannelure longitudinale correspondant au calibre
du fil, et que l’on chauffe avant de le promener douce
ment, de haut en bas, le long du fil. Puis M. Woiblet
nous a dotés en 1887 de son éperon, qui remplit encore
mieux le but (fig. 30). C’est une roulette en laiton de
20 à 21 mm. de diamètre, montée comme un éperon, et
dans laquelle ont été entaillées 26 dents triangulaires ;