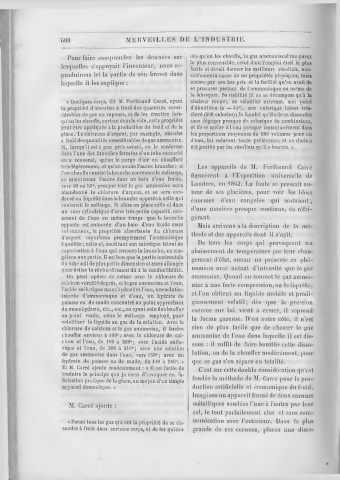Page 607 - Les merveilles de l'industrie T3 Web
P. 607
608 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
Pour faire comprendre les données sur dès qu’on les chauffe, le gaz ammoniacal me parut
le plus convenable, celui dont l’emploi était le plus
lesquelles s’appuyait l’inventeur, nous re
facile et devait donner les meilleurs résultats, non-
produirons ici la partie de son brevet dans seulementà cause de ses propriétés physiques, mais
laquelle il les explique : encore par son bas prix et la facilité qu’on avait de
se procurer partout de l’ammoniaque ou même de
la fabriquer. Sa stabilité (il ne se décompose qu’à la
« Quelques corps, dit M. Ferdinand Carré, ayant chaleur rouge), sa volatilité extrême, son point
la propriété d'absorber à froid des quantités consi d’ébullition (à —44°), son calorique latent très-
dérables de gaz ou vapeurs, et de les émettre lors élevé (500 calories) ; la faculté qu’ilade se dissoudre
qu’on les chauffe, surtout dansle vide, cette propriété sans dégager presque de calorique de combinaison,
peut être appliquée à la production du froid et de la et de se mêler à l’eau presque instantanément dans
glace. Le chlorure d’argent, par exemple, absorbe les proportions moyennes de 500 volumes pour un
à froid des quantités considérables de gaz ammoniac. d’eau, lui valurent toute préférence, et ce choix a
Si, lorsqu’il est à peu près saturé, on le renferme été justifié par les résultats qu’il a fournis. »
dans l’une des branches fermées d’un tube recourbé
en u renversé, qu’on le purge d’air en chauffant
très-légèrement, et qu’on soude l’autre branche; si Les appareils de M. Ferdinand Carré
l’on chauffe ensuite la branche contenantle mélange, figurèrent à l’Exposition universelle de
en maintenant l’autre dans un bain d’eau froide,
vers 40 ou 50°, presque tout le gaz ammoniac aura Londres, en 1862. La foule se pressait au
abandonné le chlorure d’argent, et se sera con tour de ses glacières, pour voir les blocs
densé ou liquéfié dans la branche opposée à celle qui énormes d’eau congelée qui sortaient,
contenait le mélange. Si alors on place celle-ci dans
un vase cylindrique d’une très-petite capacité, con d’une manière presque continue, du réfri
tenant de l’eau en même temps que la branche gérant.
opposée est entourée d’un bain d’eau froide assez Mais arrivons à la description de la mé
volumineux, la propriété absorbante du chlorure
d’argent vaporisera promptement l’ammoniaque thode et des appareils dont il s’agit.
liquéfiée ; celle-ci, soutirant son calorique latent de De tous les corps qui provoquent un
vaporisation à l’eau qui entoure la branche, en con abaissement de température par leur chan
gèlera une partie. Il est bon que la partie horizontale gement d’état, aucun ne présente ce phé
du tube soit de plus petite dimension et assez allongée
pour éviter le réchauffement dû à la conductibilité. nomène avec autant d’intensité que le gaz
On peut opérer de même avec le chlorure de ammoniac. Quand on soumet le gaz ammo
calcium vers200 degrés, et le gaz ammoniac et l’eau, niac à une forte compression, on le liquéfie,
l’acide sulfurique monoliydraté et l’eau, une solution
saturée d’ammoniaque et d’eau, un hydrate de et l’on obtient un liquide mobile et prodi
potasse ou de soude concentré au point approchant gieusement volatil; dès que la pression
du monohydrate, etc., etc., en ayant soin de chauffer exercée sur lui vient à cesser, il reprend
au point voulu, selon le mélange employé, pour la forme gazeuse. D’un autre côté, il n’est
volatiliser le liquide au gaz de la solution. Avec le
chlorure de calcium et le gaz ammoniac, il faudra rien de plus facile que de chasser le gaz
chauffer environ à 100°: avec le chlorure de cal- ammoniac de l’eau dans laquelle il est dis
•cium et l’eau, de 190 à 200°; avec l’acide sulfu sous : il suffit de faire bouillir cette disso
rique et l’eau, de 300 à 310°; avec une solution
lution, ou de la chauffer modérément, pour
de gaz ammoniac dans l’eau, vers 150° ; avec un
hydrate de potasse ou de soude, de 110 à 200°. » que ce gaz s’en sépare en totalité.
Et M. Carré ajoute modestement : « 11 est facile de C’est sur cette double considération qu’est
traduire le principe que je viens d’invoquer en fa
brication pratique de la glace, au moyen d’un simple fondée la méthode de M. Carré pour la pro
appareil domestique. » duction artificielle et économique du froid.
Imaginez un appareil formé de deux cornues
M. Carré ajoute : métalliques soudées l’une à l’autre par leur
col, le tout parfaitement clos et sans com
« Parmi tous les gaz qui ont la propriété de se dis munication avec l’extérieur. Dans la plus
soudre à froid dans certains corps, et de les quitter grande de ces cornues, placez une disso-