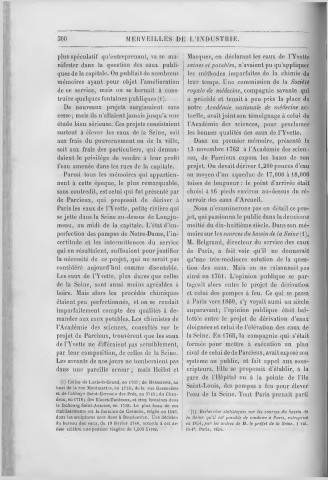Page 302 - Les merveilles de l'industrie T3 Web
P. 302
300 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
plus spéculatif qu’entreprenant, va se ma Macquer, en déclarant les eaux de l’Yvette
nifester dans la question des eaux publi saines et potables, n’avaient pu qu’appliquer
ques de la capitale. On publiait de nombreux les méthodes imparfaites de la chimie de
mémoires ayant pour objet l’amélioration leur temps. Une commission de la Société
de ce service, mais on se bornait à cons royale de médecine, compagnie savante qui
truire quelques fontaines publiques (1). a précédé et tenait à peu près la place de
De nouveaux projets surgissaient sans notre Académie nationale de médecine ac
cesse; mais ils n’allaient jamais jusqu’à une tuelle, avait joint son témoignage à celui de
étude bien sérieuse. Ces projets consistaient ' l’Académie des sciences, pour proclamer
surtout à élever les eaux de la Seine, soit les bonnes qualités des eaux de l’Yvette.
aux frais du gouvernement ou de la ville, Dans un premier mémoire, présenté le
soit aux frais des particuliers, qui deman 13 novembre 1762 à l’Académie des scien
daient le privilège de vendre à leur profit ces, de Parcieux exposa les bases de son
l’eau amenée dans les rues de la capitale. projet. On devait dériver 1,200 pouces d’eau
Parmi tous les mémoires qui appartien au moyen d’un aqueduc de 17,000 à 18,000
nent à cette époque, le plus remarquable, toises de longueur : le point d’arrivée était
sans contredit, est celui qui fut présenté par choisi à 16 pieds environ au-dessus du ré
de Parcieux, qui proposait de dériver à servoir des eaux d’Arcucil.
Paris les eaux de l’Yvette, petitç rivière qui Nous n’examinerons pas en détail ce pro
se jette dans la Seine au-dessus de Longju jet, qui passionna le public dans la deuxième
meau, au midi de la capitale. L’état d’im moitié du dix-huitième siècle. Dans son mé
perfection des pompes de Notre-Dame, l’in moire sur les sources du bassin de la Seine (1),
certitude et les intermittences du service M. Belgrand, directeur du service des eaux
qui en résultaient, suffisaient pour justifier de Paris, a fait voir qu’il ne donnerait
la nécessité de ce projet, qui ne serait pas qu’une très-médiocre solution de la ques
considéré aujourd’hui comme discutable. tion des eaux. Mais on ne raisonnait pas
Les eaux de l’Yvette, plus dures que celles ainsi en 1761. L’opinion publique se par
de la Seine, sont aussi moins agréables à tageait alors entre le projet de dérivation
boire. Mais alors les procédés chimiques et celui des pompes à feu. Ce qui se passa
étaient peu perfectionnés, et on se rendait à Paris vers 1860, s’y voyait aussi un siècle
imparfaitement compte des qualités à de auparavant; l’opinion publique était bal
mander aux eaux potables. Les chimistes de lottée entre le projet de dérivation d’eaux
l’Académie des sciences, consultés sur le éloignées et celui de l’élévation des eaux de
projet de Parcieux, trouvèrent que les eaux la Seine. En 1765, la compagnie qui s’était
de l’Yvette ne différaient pas sensiblement, formée pour mettre à exécution un plan
par leur composition, de celles de la Seine. rival de celui de de Parcieux, avait exposé son
Les savants de nos jours ne tomberaient pas système au public, et fait appel aux sous
dans une pareille erreur ; mais Hellot et cripteurs. Elle se proposait d’établir, à la
gare de lTlôpital ou à la pointe de l’île
(1) Celles de Louis-le-Grand, en 1707 ; de Desmarest, au
haut de la rue Montmartre, en 1713; de la rue Garancière Saint-Louis, des pompes à feu pour élever
et de l’abbaye Saint-Germain des Prés, en 1715 ; du Chau l’eau de la Seine. Tout Paris prenait parti
dron, en 1718; des Blancs-Manteaux, et cinq fontaines dans
le faubourg Saint-Antoine, en 1719. Le plus beau de ces
établissements est la fontaine de Grenelle, érigée en 1646, (1) Recherches statistiques sur les sources du bassin de
dont les sculptures sont dues à Bouchardon. Une décision la Seine qu'il est possible de conduire à Paris, entreprise
du bureau des eaux, du 19 février 1746, accorda à cet ar en 1854, par les ordres de Al. le préfet de la Seine. 1 vol.
tiste célèbre une pension viagère de 1,500 livres. in-4°. Paris, 1854.