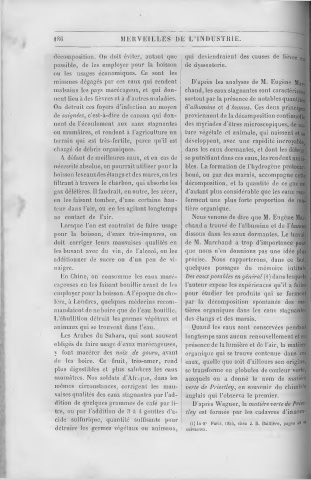Page 188 - Les merveilles de l'industrie T3 Web
P. 188
186 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
décomposition. On doit éviter, autant que qui deviendraient des causes de fièvre ou
possible, de les employer pour la boisson de dyssenterie.
ou les usages économiques. Ce sont les
miasmes dégagés par ces eaux qui rendent D’après les analyses de M. Eugène Mar.
malsains les pays marécageux, et qui don chand, les eaux stagnantes sont caractérisées
nent lieu à des fièvres et à d’autres maladies. surtout par la présence de notables quantités
On détruit ces foyers d’infection au moyen A'albumine et A'humus. Ces deux principes
de saignées, c’est-à-dire de canaux qui don proviennent de la décomposition continuelle
nent de l’écoulement aux eaux stagnantes des myriades d’êtres microscopiques, de na
ou saumâtres, et rendent à l’agriculture un ture végétale et animale, qui naissent et se
terrain qui est très-fertile, parce qu’il est développent, avec une rapidité incroyable,
chargé de débris organiques. dans les eaux dormantes, et dont les débris
A défaut de meilleures eaux, et en cas de se putréfiant dans ces eaux, les rendent nuisi
nécessité absolue, on pourrait utiliser pour la bles. La formation de l’hydrogène protocar
boisson leseauxdes étangs et des mares, en les boné, ou gaz des marais, accompagne cette
filtrant à travers le charbon, qui absorbe les décomposition, et la quantité de ce gaz est
gaz délétères. Il faudrait, en outre, les aérer, d’autant plus considérable que les eaux ren
en les faisant tomber, d’une certaine hau ferment une plus forte proportion de ma
teur dans l’air, ou en les agitant longtemps tière organique.
au contact de l’air. Nous venons de dire que M. Eugène Mar
Lorsque l’on est contraint de faire usage chand a trouvé de l’albumine et de i’Aumùs
pour la boisson, d'eaux très-impures, on dissous dans les eaux dormantes. Le travail
doit corriger leurs mauvaises qualités en de M. Marchand a trop d’importance pour
les buvant avec du vin, de l’alcool, ou les que nous n’en donnions pas une idée plus
additionner de sucre ou d’un peu de vi précise. Nous rapporterons, dans ce but,
naigre. quelques passages du mémoire intitulé
En Chine, on consomme les eaux maré Des eaux potables en général (1) dans lesquels
cageuses en les faisant bouillir avant de les l’auteur expose les expériences qu’il a faites
employer pour la boisson. A l’époque du cho pour étudier les produits qui se forment
léra, à Londres, quelques médecins recom par la décomposition spontanée des ma
mandaient de ne boire que de l’eau bouillie. tières organiques dans les eaux stagnantes
L’ébullition détruit les germes végétaux et des étangs et des marais.
animaux qui se trouvent dans l’eau. Quand les eaux sont conservées pendant
Les Arabes du Sahara, qui sont souvent longtemps sans aucun renouvellement et en
obligés de faire usage d’eaux marécageuses, présence de la lumière et de l’air, la matière
y font macérer des zio/a: de gouro, avant organique qui se trouve contenue dans ces
de les boire. Ce fruit, très-amer, rend eaux, quelle que soit d’ailleurs son origine,
plus digestibles et plus salubres les eaux se transforme en globules de couleur verte,
saumâtres. Nos soldats d’Afrique, dans les auxquels on a donné le nom de matiètt
mêmes circonstances, corrigent les mau verte de Priestley, en souvenir du chimiste
vaises qualités des eaux stagnantes par l’ad anglais qui l’observa le premier.
dition de quelques grammes de café par li D’après Wagner, la matière verte de Pries
tre, ou par l’addition de 3 à 4 gouttes d’a tley est formée par les cadavres d’innom-
cide sulfurique, quantité suffisante pour
(1) In-80 Paris, 1855, chez J. B. Baillière, pages 59 et
détruire les germes végétaux ou animaux, suivantes.