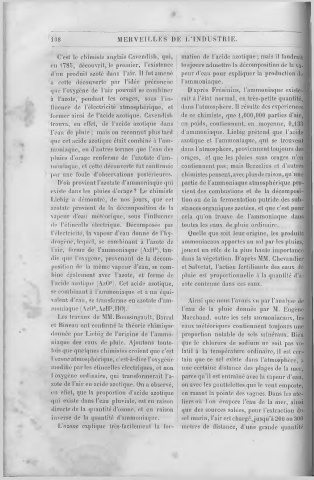Page 110 - Les merveilles de l'industrie T3 Web
P. 110
I
108 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
C’est le chimiste anglais Cavendish, qui, mation de l’acide azotique ; mais il faudrait j
en 1785, découvrit, le premier, l’existence toujours admettre la décomposition de la va-1
d’un produit azoté dans l’air. Il fut amené peur d’eau pour expliquer la production de 1
à cette découverte par l’idée préconçue l’ammoniaque.
que l’oxygène de l’air pouvait se combiner j D’après Frésénius, l’ammoniaque existe-1
à l’azote, pendant les orages, sous l’in rait à l’état normal, en très-petite quantité, I
fluence de l’électricité atmosphérique, et dans l’atmosphère. 11 résulte des expériences- ]
former ainsi de l’acide azotique. Cavendish de ce chimiste, que 1,000,000 parties d’air, j
trouva, en effet, de l’acide azotique dans | en poids, contiennent, en moyenne, 0,133 |
l’eau de pluie ; mais on reconnut plus tard | d’ammoniaque. Liebig prétend que l’acide
que cet acide azotique était combiné à l’am azotique et l’ammoniaque, qui se trouvent
moniaque, en d’autres termes que l’eau des dans l’atmosphère, proviennent toujours des 1
pluies d’orage renferme de l’azotate d’am orages, et que les pluies sans orages n'en 1
moniaque, et cette découverte fut confirmée contiennent pas; mais Berzelius et d’autres I
par une foule d’observations postérieures. ch i m istes pensent, avec plus de raison, qu’une 1
D’où provient l’azotate d’ammoniaque qui partie de l’ammoniaque atmosphérique pro
existe dans les pluies d’orage? Le chimiste | vient des combustions et de la décomposi- I
Liebig a démontré, de nos jours, que cet , tion ou de la fermentation putride des sub- I
azotate provient de la décomposition de la ! stances organiques azotées, et que c’est pour
vapeur d’eau météorique, sous l’influence I cela qu’on trouve de l’ammoniaque dans i
de l’étincelle électrique. Décomposée par toutes les eaux de pluie ordinaire.
l’électricité, la vapeur d’eau donne de l’hy- i Quelle que soit leur origine, les produits 1
drogène, lequel, se combinant à l’azote de ' ammoniacaux apportés au sol par les pluies, I
l’air, forme de l’ammoniaque (AzH3), tan- i jouent un rôle de la plus haute importance a
dis que l’oxvgène, provenant de la décom- I dans la végétation. D’après MM. Chevandier
position de la même vapeur d’eau, se com et Salvetat, l’action fertilisante des eaux de 1
bine également avec l’azote, et forme de I pluie est proportionnelle à la quantité d’a
l’acide azotique (AzO5). Cet acide azotique, | zote contenue dans ces eaux.
se combinant à l’ammoniaque et à un équi
valent d’eau, se transforme en azotate d’am Ainsi que nous l’avons vu par l’analyse de I
moniaque (AzO5, AzH3,HO). l’eau de la pluie donnée par M. Eugène 1
Les travaux de MM. Boussingault, Barrai Marchand, outre les sels ammoniacaux, les I
et Bineau ont confirmé la théorie chimique eaux météoriques contiennent toujours une I
donnée par Liebig de l’origine de l’ammo- , proportion notable de sels minéraux. Bien |
iliaque des eaux de pluie. Ajoutons toute- que le chlorure de sodium ne soit pas vo- I
iois que quelques chimistes croient que c’est latil à la température ordinaire, il est cer
V ozone atmosphérique, c’est-à-dire l’oxvgène tain que ce sel existe dans l’atmosphère, à
modifié parles étincelles électriques, et non une certaine distance des plages de la mer,, I
1 oxygène ordinaire, qui transformerait l’a parce qu’il est entraîné avec la vapeur d’eau, |
zote de l’air en acide azotique. On a observé, ou avec les gouttelettes que le vent emporte, I
en effet, que la proportion d’acide azotique en rasant la pointe des vagues. Dans les ate- I
qui existe dans l’eau pluviale, est en raison liers où l'on évapore l’eau de la mer, ainsi |
directe de la quantité d’ozone, et en raison que des sources salées, pour l’extraction dui
inverse de la quantité d’ammoniaque. sel marin, l’air est chargé, jusqu’à 200 ou 300
L’ozone explique très-facilement la for mètres de distance, d’une grande quantité |