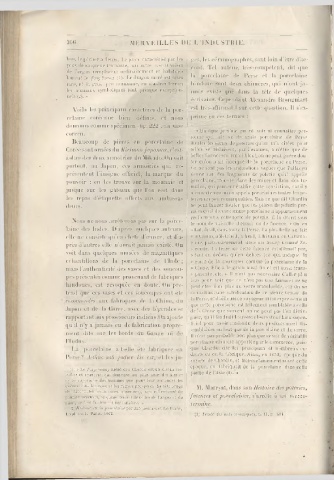Page 311 - Les merveilles de l'industrie T1
P. 311
306 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
bou, le pêcher à fleurs. Le paon caractérisé par les ' ges, les céramographes, sont loin d’être d’ac
yeux de sa queue traînante, un autre oiseau voisin cord. Tel auteur, très-compétent, dit que
de l’argus remplacent ordinairement et habituel
lement le fong-homg (I). Le dragon sacré est assez la porcelaine de Perse et la porcelaine
rare, et la grue peu commune, en d’autres termes hindoue sont deux chimères, qui n’ont ja
les animaux symboliques sont presque exception mais existé que dans la tête de quelques
nels (2). »
écrivains. Cependant Alexandre Brongniart
est très-affirmatif sur cette question. Il s’ex
Voilà les principaux caractères de la por
celaine coréenne bien définis, et nous prime en ces termes :
donnons comme spécimen (fig. 222), un vase
« Quoique je n’aie pu ni voir ni connaître per
coréen.
sonne qui ait vu de vraie porcelaine de Perse
Beaucoup de pièces en porcelaine de (toutes les sortes de poteries qu’on m’a citées pour
Corée sont ornées du Kir imon japonais, c’est- telles se réduisent, par l’examen, à n’être que de
belles faïences en émail bleu), on ne peut guère dou
à-dire des deux armoiries du Mikado. On voit
ter qu’on n’ait fabriqué de la porcelaine en Perse.
partout, au Japon, ces armoiries qui re Ce ne sont pas les indications vagues que Pallas en
présentent l’insigne officiel, la marque du donne sur des fragments de poterie qu’il appelle
pouvoir : on les trouve sur la monnaie et porcelaine, trouvés dans des mines et dans des tu-
mulus, qui peuvent établir cette conviction, car il y
jusque sur les gâteaux que l’on sert dans
a eu un temps où on appela porcelaines toutes les po
les repas d’étiquette offerts aux ambassa teries un peu remarquables. Mais ce que dit Chardin
deurs. ne peut laisser douter que les pièces de poterie per
sanes qu’il donne comme porcelaine n’appartiennent
réellement à cette sorte de poterie. 11 la décrit sous
Nous ne nous arrêterons pa's sur la porce
le nom de vaisselle d’émail ou de faïence. « On en
laine des Indes. D’après quelques auteurs, « fait, dit-il, dans toute la Perse. La plus belle se fait
elle ne consiste qu’en chefs-d’œuvre, et d’a « à Chiras, àMetched, à Yesd, à Kirman en Carama-
« nie, particulièrement dans un bourg nommé Zo-
près d’autres elle n’aurait jamais existé. On
« rende. La terre de cette faïence est d’émail pur,
voit dans quelques musées de magnifiques « tant en dedans qu’en dehors (ce qui indique le
échantillons de la porcelaine de l’Inde ; i « glacé de la couverte) comme la porcelaine de la
mais l’authenticité des vases et des soucou « Chine. Elle a le grain aussi fin et est aussi trans-
« parente, etc. » 11 n’est pas nécessaire d’aller plus
pes présentés comme provenant de fabriques
loin pour voir que ce n’est pas une faïence; ce ne
hindoues, est révoquée en doute. On pré peut être non plus un verre translucide, car on ne
tend que ces vases et ces soucoupes ont été connaît aucune vitrification de ce genre venant de
commandés aux fabriques de la Chine, du la Perse, et d’ailleurs ce voyageur dit si expressément
que cette porcelaine est tellement semblable à celle
Japon et de la Corée, avec des légendes se delà Chine que souvent on ne peut pas l’en distin
rapportant aux possesseurs indiens.On ajoute guer, qu’il faudrait le croire observateur bien super
qu’il n’y a jamais eu de fabrication propre ficiel pour avoir confondu deux produits aussi dis
semblables en tout que de la porcelaine et du verre.
ment dite sur les bords du Gange ni de
11 n'est pas probable non plus que cesoit de véritable
l’Indus. porcelaine chinoise apportée par le commerce, puis
La porcelaine a-t-elle été fabriquée en que Chardin cite les principaux et nombreux en
droits où on la fabrique. Ainsi, en 1650, époque du
Perse? Adhùc sub judice lis est, et les ju-
voyage de Chardin, et très-certainement avant cette
époque, on fabriquait de la porcelaine dans cette
(1) « Le fong-hoang sacré des Chinois est un oiseau sin
gulier et immortel qui demeure au plus haut des airs et partie de l’Asie (1). »
ne se rapproche des hommes que pour leur annoncer les
événements heureux et les règnes prospères. Sa tête ornée M. Marryat, dans son Histoire des poteries,
de caroncules (éminences charnues), son col entouré de
plumes soyeuses, sa queue tenant de celles de l’argus et du faïences et porcelaines, s’arrête à un mezzo-
paon, le font facilement reconnaître. » termirie.
(2) Histoire de la porcelaine par Jacquemart et Le Blanc,
1 vol. in-4. Paris, 1862. (1) Traité des arts céramiques, t. Il, p. 48i.