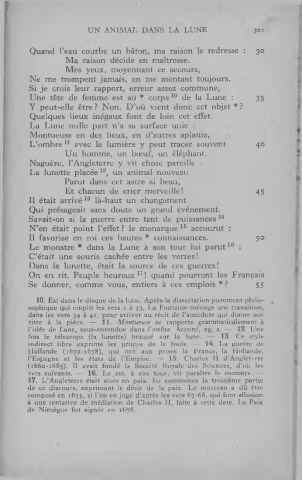Page 307 - Les fables de Lafontaine
P. 307
UN ANIMAL DANS LA LUNE 301
Quand l’eau courbe un bâton, ma raison le redresse : 30
Ma raison décide en maîtresse.
Mes yeux, moyennant ce secours,
Ne me trompent jamais, en me mentant toujours.
Si je crois leur rapport, erreur assez commune,
Une tête de femme est au * corps10 * de la Lune : 35
Y peut-elle être ? Non. D’où vient donc cet objet * ?
Quelques lieux inégaux font de loin cet effet.
La Lune nulle part n’a sa surface unie :
Montueuse en des lieux, en d’autres aplanie,
L’ombre11 avec la lumière y peut tracer souvent 40
Un homme, un bœuf, un éléphant.
Naguère, l’Angleterre y vit chose pareille :
La lunette placée12, un animal nouveau
Parut dans cet astre si beau,
Et chacun de crier merveille! 45
Il était arrivé13 là-haut un changement
Qui présageait sans doute un grand événement.
Savait-on si la guerre entre tant de puissances14
N’en était point l’effet? le monarque15 accourut :
Il favorise en roi ces hautes * connaissances. 50
Le monstre * dans la Lune à son tour lui parut16 :
C’était une souris cachée entre les verres!
Dans la lunette, était la source de ces guerres !
On en rit. Peuple heureux17! quand pourront les Français
Se donner, comme vous, entiers à ces emplois *? 55
10. Est dans le disque de la lune. Après la dissertation purement philo-
sophique qui emplit les vers i à 33, La Fontaine ménage une transition,
dans les vers 34 à 41, pour arriver au récit de l’anecdote qui donne son
titre à la pièce. — 11. Montueuse se rapporte grammaticalement à
l’idée de Lune, sous-entendue dans l'ombre. Accord, 29, a. — 12. Une
fois le télescope (la lunette) braqué sur la lune. — 13. Ce style
indirect libre exprime les propos de la foule. — 14. La guerre de
Hollande (1672-1678), qui mit' aux prises la France, la Hollande,
l’Espagne et les états de l’Empire. — 15. Charles il d’Angleterre
(1660-1685). Il avait fondé la Société Royale des Sciences, d’où les
vers suivants. — 16. Le ,roi, à son tour, vit paraître le monstre. —
17. L’Angleterre était alors en paix. Ici commence la troisième partie
de ce discours, exprimant le désir de la paix. Le morceau a dû être
composé en 1675, si l’on en juge d’après les vers 67-68, qui font allusion
à une tentative de médiation de Charles II, faite à cette date. La Paix
de Nimègue fut signée en 1678.