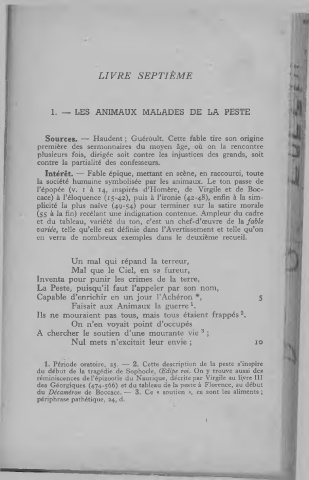Page 271 - Les fables de Lafontaine
P. 271
LIVRE SEPTIÈME
1. — LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE
Sources. — Haudent ; Guérôult. Cette fable tire son origine
première des sermonnaires du moyen âge, où on la rencontre
plusieurs fois, dirigée soit contre les injustices des grands, soit
contre la partialité des confesseurs.
Intérêt. — Fable épique, mettant en scène, en raccourci, toute
la société humaine symbolisée par les animaux. Le ton passe de
l’épopée (v. l à 14, inspirés d’Homère, de Virgile et de Boc-
cace) à l’éloquence (15-42), puis à l’ironie (42-48), enfin à la sim
plicité la plus naïve (49-54) pour terminer sur la satire morale
(55 à la fin) recélant une indignation contenue. Ampleur du cadre
et du tableau, variété du ton, c’est un chef-d’œuvre de la fable
•variée, telle qu’elle est définie dans l’Avertissement et telle qu’on
en verra de nombreux exemples dans le deuxième recueil.
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel, en sa fureur,
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste, puisqu’il faut l’appeler par son nom,
Capable d’enrichir en un jour l’Achéron *, 5
Faisait aux Animaux la guerrex.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés2.
On n’en voyait point d’occupés
A chercher le soutien d’une mourante vie 3 ;
Nul mets n’excitait leur envie ; 10
1. Période oratoire, 25. — 2. Cette description de la peste s’inspire
du début de la tragédie de Sophocle, Œdipe roi. On y trouve aussi des
réminiscences de l’épizootie du Naurique, décrite par Virgile au li,vre III
des Géorgiques (474-566) et du tableau de la peste à Florence, au début
du Décaméron de Boccace. — 3. Ce « soutien », ce sont les aliments ;
périphrase pathétique, 24, d.
I